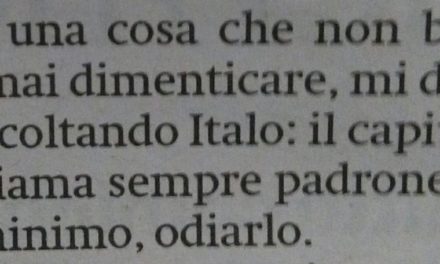de PIERRE MACHEREY.
Il est impossible de faire de l’histoire actuellement sans utiliser une kyrielle de concepts liés directement ou indirectement à la pensée de Marx et sans se placer dans un horizon qui a été décrit et défini par Marx. A la limite on pourrait se demander quelle différence il pourrait y avoir entre être historien et être marxiste. (Foucault, entretien donné en 1975 au Magazine littéraire, Dits et Ecrits, t. II, éd. Gallimard, 1994, p. 753)
Le pouvoir, de la politique à l’économie
Dans la partie conclusive de La volonté de savoir (éd. Gallimard, 1976), Foucault explique comment il a été amené à considérer le pouvoir, tel qu’il existe aujourd’hui, d’un point de vue, non pas négatif, comme une contrainte dont la forme est au départ juridique, mais positif, en tant qu’il repose sur des mécanismes qui, au lieu d’imposer à la vie humaine des bornes, l’organisent sur un plan matériel, et même contribuent à la « produire ». C’est cette idée qui est au principe de la conception du « bio-pouvoir », à propos duquel il écrit :
« Ce bio-pouvoir a été, à n’en pas douter, un élément indispensable au développement du capitalisme ; celui-ci n’a pu être assuré qu’au prix de l’insertion contrôlée des corps dans l’appareil de production et moyennant un ajustement des phénomènes de population aux processus économiques. Mais il a exigé davantage ; il lui a fallu la croissance des uns des autres, leur renforcement en même temps que leur utilisabilité et leur docilité ; il lui a fallu des méthodes de pouvoir susceptibles de majorer les forces, les aptitudes, la vie en général sans pour autant les rendre plus difficiles à assujettir ; si le développement des grands appareils d’Etat, comme institutions de pouvoir, a assuré le maintien des rapports de production, les rudiments d’anatomo- et de bio-politique inventés au XVIIIe siècle comme techniques de pouvoir présentes à tous les niveaux du corps social et utilisées par des institutions très diverses (la famille comme l’armée, l’école ou la police, la médecine individuelle ou l’administration des collectivités), ont agi au niveau des processus économiques, de leur déroulement, des forces qui y sont à l’œuvre et les soutiennent ; ils ont opéré aussi comme des facteurs de ségrégation et de hiérarchisation sociale, agissant sur les forces respectives des uns et des autres, garantissant des rapports de domination et des effets d’hégémonie ; l’ajustement de l’accumulation des hommes sur celle du capital, l’articulation de la croissance des groupes humains sur l’expansion des forces productives et la répartition différentielle du profit, ont été, pour une part, rendus possibles par l’exercice du bio-pouvoir sous ses formes et avec ses propriétés multiples. L’investissement du corps vivant, sa valorisation et la gestion distributive de ses forces ont été à ce moment-là indispensables. » (VS, p. 185-186)
En schématisant, on peut dire que, dans cette page, Foucault expose la nécessité de repenser le pouvoir en le détachant de l’emprise du politique pour le rapprocher du plan où se déroule concrètement l’économie, une économie qui, avant même d’être ciblée sur la valeur de biens échangeables, au titre d’une économie de choses, se préoccupe principalement de la gestion de la vie, des corps et de leurs « forces », terme qui revient ici de manière lancinante. Par ailleurs, il lui importe de restituer à cette nouvelle conception du pouvoir une dimension historique, ce qu’il fait en l’associant au développement du capitalisme et des rapports sociaux de productions très particuliers mis en œuvre par celui-ci dans le contexte de la révolution industrielle : bien que le mot « classe » ne soit pas énoncé, il est manifestement sous-entendu lorsque sont évoqués au passage les « facteurs de ségrégation et de hiérarchisation sociale agissant sur les forces respectives des uns et des autres, garantissant des rapports de domination et des effets d’hégémonie » et « l’articulation de la croissance des groupes humains sur l’expansion des forces productives et la répartition différentielle du profit ». Ici, Foucault peut paraître tout proche de flirter avec les analyses de Marx dans Le Capital, qu’il concilie avec son effort en vue de replacer le pouvoir dans une perspective positive et « productive ».
Cinq ans plus tard, revenant sur ce point dans une conférence donnée à Bahia en 1981, publiée sous le titre imagé « Les mailles du pouvoir » (Dits et Ecrits, t. IV, éd. Gallimard, 1994, p. 182 et sq.), Foucault confirme explicitement ce rapprochement. Il y déclare :
« Comment pourrions-nous essayer d’analyser le pouvoir dans ses mécanismes positifs ? Il me semble que nous pouvons trouver, dans un certain nombre de textes, les éléments fondamentaux pour une analyse de ce type. Nous pouvons les trouver peut-être chez Bentham, un philosophe anglais de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, qui, au fond, a été le grand théoricien du pouvoir bourgeois, et nous pouvons évidemment le trouver aussi chez Marx, essentiellement dans le livre II du Capital. C’est là je pense que nous pourrons trouver quelques éléments dont je me servirai pour l’analyse du pouvoir dans ses mécanismes positifs. » (DE IV, p. 186)
Foucault veut dire que Bentham et Marx, même s‘ils le font de manière différente, parlent au fond de la même chose : l’apparition d’une nouvelle configuration de pouvoir, qui coïncide avec l’avènement du capitalisme et de la bourgeoisie, et n’a pas seulement consisté en une mutation institutionnelle ou une prise du pouvoir politique parce qu’elle a reposé, à la base, sur une prise en charge originale des forces mêmes de la vie, qui donnent sa matière propre à l’économie, une économie dont les transformations on impulsé le changement social. On pourrait soutenir que cette façon de voir va dans le sens de la thèse d’une détermination en dernière instance par l’économie, sous réserve d’un élargissement du concept de celle-ci, élargissement au terme duquel ce concept comprend la gestion, ou, pour reprendre le terme ambigu utilisé par Foucault, la « production » de la vie sous toutes ses formes. Dans la suite de sa conférence, en réaffirmant à chaque fois de manière appuyée la référence à Marx, Foucault énumère les quatre aspects qui caractérisent cette mutation historique et sociale du pouvoir : sa déconcentration en une multiplicité de pouvoirs hétérogènes, son désengagement de la forme étatique, son orientation positive et non plus prohibitive et répressive, et enfin sa technicisation progressive qui a procédé par essais et par erreurs, sans être planifiée, donc sans être soumise à des fins conçues et prescrites intentionnellement au départ. Ce dernier point est celui auquel Foucault accorde le plus d’importance ; c’est lui qui est évoqué dans le passage de La Volonté de Savoir qui a été cité où il est question « des méthodes de pouvoir susceptibles de majorer les forces, les aptitudes, la vie en général sans pour autant les rendre plus difficiles à assujettir ».
Lorsque Foucault donne en référence « le livre II du Capital », il pense manifestement au second tome de l’édition française de l’ouvrage de Marx publiée aux Editions Sociales, qui comprend les sections 4, 5 et 6 du livre I du Capital, le seul qui a paru de son vivant, la rédaction définitive des livres II et III ayant été effectuée après sa mort par Engels. Althusser, dans la préface qu’il avait rédigée pour la publication en 1969 du livre I duCapital dans la collection GF Flammarion, avait préconisé de le lire en commençant directement par la deuxième section, donc en sautant la première, celle dont l’interprétation pose le plus de problèmes, des problèmes qui ne sont susceptibles d’être résolus que lorsqu’on est arrivé à la fin de l’ouvrage et qu’on en a maîtrisé l’argumentation en totalité. Foucault semble aller plus loin encore, en conseillant d’aborder l’ouvrage de Marx par la quatrième section, celle qui est consacrée à « La production de la plus-value (ou survaleur,Mehrwert) relative » : en effet, c’est dans celle-ci qu’il voit apparaître pour la première fois les éléments permettant de déterminer la nouvelle configuration de pouvoir annoncée dès la fin du XVIIIe siècle par un théoricien comme Bentham, qui est celle du « pouvoir bourgeois » dont Marx aurait le mieux contribué à analyser les mécanismes, c’est-à-dire les procédures particulières telles qu’elles relèvent d’une technologie du pouvoir. En polarisant l’attention sur cette partie de l’ouvrage, Foucault trouve du même coup le moyen de prendre distance avec la présentation polémique qu’il avait lui-même donnée dans Les Mots et les Choses, non à proprement parler de la pensée de Marx telle qu’elle est déposée dans ses écrit mais de ce qui en est issu sous la forme d’une vulgate « marxiste », dans laquelle il avait décelé un avatar ou un épiphénomène de l’économie politique sous la forme qui lui avait été donnée par Ricardo, rien de plus. Tout se passe de ce point de vue comme si Foucault proposait d’ajouter un nouveau chapitre à l’entreprise dans laquelle Althusser s’était lui-même engagé en publiant Lire le Capital, où était déjà amorcée une remise en cause de la vulgate marxiste traditionnelle.
Qu’est-ce qui a pu intéresser Foucault dans les passages du Capital qui commencent à la section 4 au point qu’il les présente comme les sources d’une étude positive du pouvoir, enracinée dans le développement de l’économie et de ses « forces » ? C’est ce point que nous voudrions élucider en revenant sur le texte de Marx, dont la proposition de Foucault incite à faire une lecture qu’on peut dire « symptomale », car il ne va du tout de soi, à première vue, d’en tirer les principes qu’une analyse du « pouvoir », qui y est au mieux sous-jacente, présente en filigrane. Pour poser crûment la question qui va nous préoccuper, comment, de l’explication du processus de production de la plus-value relative, est-il possible, sans tomber dans la surinterprétation, de tirer les éléments d’une théorie du pouvoir, alors que le problème du pouvoir, s’il n’est pas tout à fait étranger à cette explication, n’y est soulevé qu’à la marge ? Disons tout de suite que cette question, qui met en jeu la relation particulière que le pouvoir entretient avec l’économie du capitalisme, ce qui conduit à mettre entre parenthèses les rapports qu’il peut avoir par ailleurs avec des formes étatiques et politiques, amène à prendre en compte en lui restituant une importance primordiale la notion que Marx a lui-même présentée comme étant sa principale innovation théorique, celle avec laquelle il prétendait rompre radicalement avec l’économie ricardienne : la notion de « force de travail », dans la formulation de laquelle se trouve justement la référence à la « force », référence à laquelle Foucault accorde une telle importance dans sa propre conception de la nouvelle économie du pouvoir ; de cette économie on peut dire qu’elle n’est pas une économie de choses ou une économie de biens, mais une économie de « forces » qui, comme telle, est aussi, indissociablement, une économie de personnes, une économie qui, concrètement, se trouve articulée à des procédures d’assujettissement des personnes, et plus précisément des corps. Pour reprendre les termes utilisés par Foucault, nous allons donc avoir à nous demander comment, en mettant en œuvre l’exploitation de la force de travail, le capitalisme a élaboré « des méthodes de pouvoir susceptibles de majorer les forces, des aptitudes, la vie en général sans pour autant les rendre plus difficiles à assujettir ». Précisons que le but d’une telle enquête n’est pas de démontrer que les idées avancées par Foucault se trouvaient déjà inscrites en toutes lettres dans le texte de Marx, ce qui reviendrait à forger la fiction d’un Foucault « marxiste » ou « marxisant », comme tel héritier de Marx, mais d’enrichir la compréhension que nous pouvons avoir de ce texte en l’éclairant à la lumière des hypothèses avancées par Foucault, donc en parcourant le chemin qui ramène de Foucault vers Marx, dans l’espoir de faire apparaître la pensée de ce dernier sous un jour nouveau, et en particulier, c’est le point qui nous préoccupe ici prioritairement, de reposer la question du pouvoir en la déplaçant du plan de la politique sur celui de l’économie1.
Le régime du salariat et l’exploitation de la force de travail
Pour répondre aux questions qui viennent d’être soulevées, il faut d’abord revenir sur la théorie du salariat, qui, selon la présentation qu’en donne Marx, constitue la base de l’économie capitaliste, et distingue radicalement celle-ci des modes de production antérieurs. Résumons cette théorie à très grands traits. Dans le contexte propre au capitalisme, la production de marchandises porteuses de valeur, donc échangeables, repose sur la consommation productive de la force de travail ; cette dernière, la force de travail, est la propriété du prolétaire, et le capitaliste acquiert, en échange d’un salaire, le droit d’en user durant un certain temps à l’intérieur de l’espace de son entreprise où elle est « consommée ». Lorsqu’il évoque ce contrat de travail, il arrive assez souvent à Marx d’écrire que le prolétaire vend au capitaliste sa force de travail, formule abrégée qui, prise à la lettre, est trompeuse. En effet, ce que le travailleur aliène en échange d’un salaire, ce n’est pas sa force de travail en tant que telle, considérée dans sa substance qui lui est incorporée en ce sens qu’elle est indissociable et même indiscernable de son existence corporelle : car, s’il le faisait, il deviendrait d’une certaine manière, l’esclave de son employeur, il ne s’appartiendrait plus, ce qui aurait pour conséquence qu’il perdrait la responsabilité d’entretenir lui-même cette substance qui fait corps avec sa personne. En échange du salaire, le prolétaire ne concède en réalité que le droit d’exploiter sa force de travail durant un certain temps et en un certain lieu, c’est-à-dire proprement qu’il la loue, avec cette particularité que le règlement du loyer qui lui est versé en échange dans le cadre de cette transaction est différé, le salaire n’étant effectivement versé qu’après usage et non avant, comme c’est le cas dans la plupart des contrats locatifs : cette disposition déséquilibre d’emblée le rapport d’échange, dans la mesure où elle représente une pression exercée par le payeur sur le vendeur. Il résulte de tout cela que, si l’on veut comprendre ce que c’est que le travail salarié, il faut faire soigneusement la distinction entre la force de travail en tant que telle, ce que nous avons appelé sa substance, et son emploi, qui est mesuré dans le temps et dans l’espace, l’unité de base de cette mesure étant formellement constitué par la journée de travail telle qu’elle est effectuées dans le cadre de l’entreprise (jusqu’à la fin du XIXe siècle en tout cas, les travailleurs manuels étaient généralement embauchés, et rémunérés, à la journée, ce qui les différenciait des employés) : le régime du salariat, qui détermine la relation du capital au travail, suppose la dissociation de ces deux aspects, donc que la force de travail, en tant que disposition dont le corps est le porteur durant tout le temps de la vie, soit, dans les faits, séparée des conditions de son activation telle qu’elle s’effectue dans certaines limites temporelles et à l’intérieur de l’espace propre à l’entreprise, où le travailleur doit se rendre, en apportant avec lui sa force de travail, pour que celle-ci puisse être utilisée dans des conditions appropriées. La capacité existentielle reste la propriété inaliénable du travailleur qui, en échange d’un salaire, concède à son patron la possibilité de s’en servir, de la mettre en œuvre à son profit durant un certain temps et dans un cadre déterminé. Ceci est un premier point, qui fait apparaître que la notion de force de travail, alors qu’elle se présente au départ comme une donnée naturelle simple et unifiée, comme « puissance » ayant ses sources dans la vie et dans le corps, est beaucoup plus complexe : on peut avancer que l’intervention historique du capitalisme et de son mode de production spécifique a précisément pour effet de la compliquer, en exploitant la division qui vient d’être évoquée, ce qui n’a rien du tout de naturel.
Foucault serait légitimé de parler à ce propos d’une procédure technique, de laquelle découle l’installation d’une relation de pouvoir : en effet, lorsqu’il échange l’emploi de sa force de travail contre un salaire, le travailleur n’est que formellement « libre » de le faire ; pour que la procédure marche, il faut que, dans les faits, il y soit obligé parce que, pour survivre, il se trouve placé dans la position de demandeur d’emploi, une position dont on peut dire qu’elle est soumise dans la mesure où elle répond à une nécessité « économique » qui n’a rien de juridique en dernière instance. Autrement dit, le fait que la force de travail soit dissociée de son usage est conditionné historiquement : il correspond au développement d’un mode de production spécifique, qui repose sur l’exploitation de la force de travail rendue possible par cette dissociation, dont le tout premier effet est de lier le détenteur de la force de travail, l’ouvrier, aux contraintes du marché du travail ; en effet, il ne suffit pas qu’il « aie » sa force de travail, au sens où son corps est à lui, encore faut-il que celle-ci puisse être mise en œuvre dans certaines conditions, ce qui ne dépend pas de lui.
Mais ce n’est pas tout. Le salariat se présente au départ comme un échange, qui, comme tout échange marchand, doit en principe s’effectuer à valeur égale. Ce que le travailleur apporte sur le marché du travail, c’est lui-même, son corps, sa force de travail, dont il aliène l’usage ; et, pour cela, il reçoit un salaire qui, en principe, doit payer ce qu’il a vendu à sa valeur, qui correspond à son entretien durant la période où il en a concédé l’usage : par entretien, il faut comprendre tout ce qui permet de régénérer cette force selon ses besoins, en comprenant dans ceux-ci ce qui est requis, non seulement par la survie individuelle de l’ouvrier, mais par celle de sa famille, où se fabrique, en même temps que sa force propre de travail, celle de sa descendance, sur laquelle le capitaliste, lorsqu’il verse le salaire, dépose une option, exerçant ainsi une sorte de droit de préemption. Pour que le système fonctionne normalement, selon les règles, ce qui le rend inattaquable sur le plan du droit, il faut que la marchandise soit payée à son juste prix, qui fluctue autour d’une valeur moyenne déterminée par la conjoncture, c’est-à-dire par les variations du rapport entre l’offre et la demande, comme c’est le cas pour tout échange. Lorsqu’il perçoit son salaire, l’ouvrier n’est donc pas volé, spolié, ce qu’il reconnaît implicitement lorsqu’il se plie aux conditions de l’échange dont on peut dire que, formellement, il les accepte de son plein gré. Toutefois, il est impossible d’en rester là. Pour que l’échange ait effectivement lieu, il faut qu’il réponde à des intérêts, qui lient concrètement les parties contractantes. L’intérêt du vendeur apparaît en toute clarté : l’ouvrier aliène l’usage de sa force de travail contre salaire parce que, sans celui-ci, il ne pourrait subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; s’il apporte sur le marché du travail sa « marchandise », c’est tout simplement parce qu’il ne peut faire autrement : c’est la condition de sa survie. Mais pour ce qui concerne l’acheteur, qui va employer cette force de travail à son bénéfice, les choses sont beaucoup moins claires : ce qu’il a acheté à sa valeur, le capitaliste entend en effet l’exploiter, non à valeur égale, mais pour en tirer un supplément de valeur qui est destiné à constituer son profit, un profit qui va servir soit à accroître sa production soit à augmenter sa fortune ; de quelque côté qu’on se tourne, il y gagne, et, si ce n’était pas le cas, l’affaire ne l’intéresserait en aucun cas. Il y a donc quelque chose de bizarre, une anomalie, dans la relation qui se met ainsi en place. Dans le cadre de l’échange entre le salarié et celui qui le rétribue, l’un, le travailleur, si, à proprement parler, il ne perd rien, ne gagne rien non plus, c’est-à-dire qu’il ne peut espérer rien gagner de plus que ce qu’il a engagé au départ ; et, s’il se révèle que son salaire dépasse de si peu que ce soit ses besoins réels, ce qui lui permet soit de dépenser en pure perte, pour le superflu, soit d’économiser pour son compte personnel, la rectification s’effectue de manière quasiment automatique, et son salaire baisse, entraînant à terme avec lui la baisse de la valeur moyenne du salaire versé à tous les autres travailleurs. Alors que, dans le cadre de ce même échange, l’autre, l’acheteur prétend, non seulement récupérer sa mise, donc ne rien perdre, mais l’augmenter, ce qui prouve que l’échange à valeur égale duquel le salariat tire sa légitimité sur le plan du droit cache un tour de passe-passe qui métamorphose l’égalité en inégalité, sans que pour autant le droit marchand de l’échange ait été formellement violé. Que s’est-il passé ?
Pour le comprendre, il n’est pas absurde d’appliquer à l’échange que sanctionne le contrat de travail, un échange qui met en relation deux parties sur le mode du donnant-donnant, le schéma élaboré par Mauss pour rendre compte, dans un tout autre contexte, du mécanisme du don. Ce schéma est triangulaire : il articule entre elles trois opérations qui sont « donner », « recevoir », « rendre ». Supposons que le contrat de travail qui est à la base du salariat rentre sous ce schéma. Le donneur, dans ce cas, est celui qui propose une marchandise dont il cherche à se dessaisir : c’est le travailleur qui apporte sur le marché sa force de travail, son corps, dont il loue l’emploi à quelqu’un d’autre. En échange de quoi, lui est « rendue » par l’acheteur, son futur employeur, une valeur égale aux besoins d’entretien de cette force. Mais, lorsque cet acheteur est le capitaliste, ce qui est ainsi « rendu », restitué sous forme de salaire, n’est pas exactement la même chose que ce qui est « reçu » par celui qui, dans le cadre de cet échange, occupe la position d’acquéreur : c’est la condition pour que cet échange à valeur égale produise de l’inégalité. Pour le dire autrement, ce dont le capitaliste prend possession contre versement du salaire, ce qui lui confère le droit de l’exploiter à son idée, de manière conforme à ses intérêts, n’est pas exactement la même chose que ce qui a été apporté, « donné », ou formellement vendu, en échange de ce salaire. Réapparaît donc à ce niveau la division qui a déjà été signalée : celle-ci dissocie dans la force de travail deux aspects, dont l’un est celui qui est « donné » par le vendeur, le travailleur, et l’autre est celui qui est « reçu » par l’acheteur, le capitaliste ; c’est sur cette dissociation que repose le tour de passe-passe dont il a était question, qui fait d’un échange à valeur égale une opération qui profite à une seule de ses parties contractantes, ce qui n’est possible que parce que cet échange s’effectue dans le cadre d’une relation de pouvoir où l’un, le vendeur, occupe la position dominée et l’autre, l’acheteur, la position dominante, ce qui lui permet de faire prévaloir son intérêt. La condition pour que le régime du salariat produise tous ses effets est donc que le travailleur ait été installé dans la position d’un sujet clivé qui, demeurant entièrement maître de sa force de travail, en a aliéné seulement l’usage, ce qui suppose que cette force puisse être séparée matériellement de son usage.
On mesure à partir de là la rupture introduite dans la présentation raisonnée du régime du salariat par la substitution de la force de travail au travail, rupture que Marx présente comme étant sa principale innovation théorique (commentée par Engels, en 1891, dans sa préface à l’édition anglaise de Travail salarié et Capitalde Marx). Si le vendeur, le salarié, aliénait son travail, et si celui-ci lui était payé à valeur égale, comme l’économie classique jusqu’à Ricardo le suppose pour tout échange, l’acheteur, le capitaliste, ne gagnerait rien de plus, et l’échange n’aurait pas lieu, tout simplement parce qu’il ne présenterait pas d’intérêt pour lui. Mais si ce que le vendeur apporte, « donne », c’est sa force de travail, ou du moins la possibilité de l’employer durant un certain temps, il en va tout autrement : car ce qui est transmis, « reçu » au terme de l’échange, n’est pas exactement la même chose que ce qui a été apporté au départ ; ce qui est reçu, c’est la possibilité d’employer la force de travail au-delà de sa valeur réelle, donc de récupérer un profit de son usage, profit que se réserve celui qui a acheté ce droit d’emploi à sa valeur, qui est celle, non de ce qu’il produit, mais de ce qui le produit, c’est-à-dire la valeur nécessaire à l’entretien de la force qui, une fois produite, produit, en étant porteuse de la capacité de produire au-delà de la valeur de ce qui est nécessaire pour la produire. En anticipant sur les notions qui vont être introduites un peu plus loin, on peut dire que, au moment où il accepte les dispositions stipulées par son contrat d’embauche, le travailleur subit une mutation quasi miraculeuse : il cesse d’être son corps en personne, dont l’existence n’est, par définition pareille à nulle autre, et il devient « sujet productif », porteur d’une « force de travail » dont les performances, en tant qu’elles représentent su « travail social », sont soumises à une évaluation commune2 ; et, de cette façon, il est, à tous les sens du mot, assujetti.
Ce qui est ici en jeu, c’est l’équivoque dont est affectée la notion de travail, une équivoque redoublée par la langue française qui confond dans un même terme deux choses que la langue anglaise et la langue allemande distinguent : d’une part, ce qui est connoté par ces deux langues sous les termes Werk et work, c’est-à-dire le résultat du travail, une fois celui-ci accompli, donc lorsque celui-ci a atteint son but ; et d’autre part ce qui est connoté sous les termes Arbeit et labour, c’est-à-dire l’opération ou le processus qui produit, c’est-à-dire l’activité de production en tant qu’elle est effectivement en cours, et se dirige vers ce but qu’elle n’a pas encore atteint. On peut dire que c’est cette distinction terminologique que Marx reprend à son compte lorsqu’il parle, de manière métaphorique, de « travail mort » et de « travail vivant ». Le travail mort, c’est le travail « fini », objectivé, cristallisé dans son produit où sa trajectoire s’est achevée. Le travail vivant, c’est le travail en cours d’effectuation, sur un plan qui lui confère une portée proprement dynamique, alors que le produit que représente le travail mort ne présente qu’une dimension statique. Lorsqu’il a forgé le concept de « force de travail », qui constitue son apport propre à la théorie du salariat, Marx a fait rentrer dans cette formule composée ces deux aspects, comme le fait dans la réalité le mode de production capitaliste qui suppose la possibilité de les substituer l’un à l’autre, alors même qu’ils correspondent à des déterminations différentes. La force de travail, c’est d’un côté, son côté qu’on peut dire dynamique, une force, avec la dimension de puissance qui la définit et dont le travail vivant est porteur3 ; et c’est de l’autre côté, qui serait son côté statique, du travail, au sens du résultat du procès de travail lorsque celui-ci a atteint son but, c’est-à-dire du travail mort. La notion de force de travail, qui articule entre eux ces deux aspects, permet ainsi de comprendre ce qui se passe réellement lorsque le travail vivant se transforme en du travail mort et réciproquement4.
Reprenons sur ces bases le modèle triangulaire du don. Ce que le travailleur apporte sur le marché du travail pour l’échanger contre un salaire, c’est quelque chose qui représente économiquement du travail mort, c’est-à-dire la valeur des biens nécessaires à son entretien, qui permettent à sa force de travail d’exister, en tant qu’elle-même est le produit d’un travail dont la valeur est égale à celle de ces biens, et c’est ce qui lui est payé, « rendu » par le salaire ; c’est à ce point de vue un produit. Mais ce que le capitaliste « reçoit », en vue de l’exploiter, c’est du travail vivant, la possibilité de mettre en oeuvre, d’activer la puissance dont la force de travail est porteuse lorsqu’elle est exploitée au-delà de ce qui est nécessaire à la production des biens servant à son entretien, durant la portion de son temps où l’ouvrier, ayant cessé de travailler pour lui-même, travaille pour le capitaliste, c’est-à-dire à son profit : ce n’est plus à proprement parler un produit, mais c’est ce que Marx appelle assez énigmatiquement une « force productive », entendons une force définie par l’activité de production qu’elle est conditionnée à mettre en oeuvre. En jouant sur les termes, on dira que ce que le travailleur aliène, c’est l’usage de sa Arbeitskraft, sa force de travail en tant qu’elle est toute constituée puisqu’elle fait corps avec lui ; et ce que le capitaliste exploite, c’est unArbeitsvermögen, qui a à être mis en œuvre dans le cadre d’une activité productive à travers une procédure d’extériorisation. On comprend alors pourquoi le capitaliste est gagnant, et même gagnant gagnant, dans un échange qui est en principe égal, et qui est en réalité un marché de dupes, comme le sont la plupart des rapports juridiques, dans la mesure où ils enveloppent, sans le dire, un rapport qui, lui, n’est pas de l’ordre du juridique.
La question est alors de savoir comment un telle chose, invraisemblable lorsque le principe en est révélé, peut arriver à se réaliser dans les faits. Qu’est-ce qui amène le travailleur à se plier « librement », les guillemets sont dans le texte de Marx, aux conditions de cet étrange contrat à valeur égale en principe, mais en principe seulement, puisque seule l’une des parties contractantes sort gagnante, et même gagnante gagnante, d’un tel échange dont on ne pas dire que réellement il « profite » à l’autre partie qui, elle, s’engage dans ce rapport parce qu’elle ne peut faire autrement ? On peut expliquer cette anomalie de la manière suivante : dans le cadre de l’échange en question, la réciprocité n’est qu’apparente parce que, dans le cours même de l’échange, suivant sa trajectoire propre, ce qui en constitue la matière s’est transformé. Au départ de cette trajectoire, il y a, avons-nous supposé, l’Arbeitskraft du travailleur, c’est-à-dire sa force de travail, entendons sa force de travail personnelle, qui est incorporée à son existence d’individu : et c’est en tant qu’individu, précisément, qu’il s’offre à passer en son nom propre le contrat de travail par lequel il aliène l’usage de sa force de travail durant un certain temps en échange d’un salaire. Mais, à l’arrivée, c’est-à-dire lorsque l’acheteur, le capitaliste, prend livraison de la marchandise dont il s’est porté acquéreur, celle-ci se présente sous un tout nouveau jour : elle est devenuede la force de travail, exploitable dans des conditions qui ne sont plus celles d’une activité de travail individuelle, marquée par les caractères spécifiques attachés aux capacités d’initiative de la personne qui effectue le travail, mais qui définissent une activité productive en général, soumise à des normes communes. Sans même s’en rendre compte, le travailleur, une fois entré dans le régime du salariat, a cessé d’être la personne qu’il est, avec sonArbeitskraft individuellement constituée, et, proprement assujetti, il est devenu l’exécutant d’une opération qui dépasse les limites de son existence propre : cette opération, c’est le « travail social », qui n’est plus à proprement parler, du moins qui n’est plus seulement son travail à lui, mais est du travail, qui doit être effectué sous des conditions qui échappent à son initiative et à son contrôle ; ces conditions sont celles de sa régulation ou rationalisation, c’est-à-dire de ce qui s’appellera à la fin du XIXe siècle, chez Taylor en particulier, « organisation du travail », dont le schéma se trouve déjà tracé chez Marx. Pour reprendre la terminologie que nous avons précédemment employée, ce que « donne » le travailleur, c’est l’usage de son corps en tant que celui-ci est porteur d’une force qui est la sienne ; et ce que « reçoit » le capitaliste, en vue de l’exploiter à son profit, c’est le droit de se servir de cette force en tant que force productive dont les capacités sont répertoriées, calibrées, formatées, et peut-on dire normalisées en fonction de principes qui en conditionnent l’usage optimal, au sens où on parle du conditionnement d’un produit, opération au terme de laquelle celui-ci est requalifié en vue de s’adapter à des règles communes. Si l’échange que sanctionne le régime du salariat a lieu, c’est parce que, au cours de l’échange, ce qui sert de véhicule à l’échange a été transformé, sans que celui qui est demandeur dans ce rapport en ait conscience, ce qui a pour conséquence que cette transformation n’est pas prise en compte dans le calcul des termes de l’échange, un échange qui s’effectue à valeur égale tout en étant inégal, conformément à l’intérêt de celui qui, dans ce même rapport, occupe à la fois la position de payeur et celle de récepteur ou de preneur. Ce qui définit le mode de production capitaliste, c’est que la force de travail y soit traitée comme une réalité à deux faces, donc qu’elle ne soit pas exactement la même chose pour celui qui en est naturellement le porteur et pour celui qui en est devenu l’utilisateur, ce dont résulte la possibilité de tirer de son utilisation un profit dont le capitaliste se réserve le bénéfice, sous la forme d’une plus-value ou survaleur (Mehrwert) qui n’est pas payée par le salaire et en conséquence se présente comme un excédent. Tel est le « truc » sur lequel repose l’exploitation du travailleur qui, tout en restant maître de sa force de travail s’est dessaisi de son usage, comme si son usage ne faisait plus partie de cette force et comme si cette force existait indépendamment du fait d’être employée : il s’agit d’un véritable tour de prestidigitation dont le mécanisme demeure caché, ce qui est la condition pour qu’il produise ses effets. Ceci incite à élargir l’extension du concept de révolution industrielle, concomitante au développement du capitalisme : celle-ci a reposé sur l’invention, outre de machines sophistiquées (dont le prototype est la machine à vapeur), de la « force productive » indispensable pour faire fonctionner ces machines, la « force de travail », résultat d’une création technique associée, comme l’explique Foucault après Marx, à l’installation de procédures de pouvoir spécifiques. Le machinisme est un régime de production complexe qui comprend, à côté d’un appareillage matériel, les agents plus ou moins qualifiés ou déqualifiés qui le font marcher et qui, du même coup, sont incorporés à son système en tant que porteurs d’une force de travail destinée à être consommée productivement. C’est précisément ce que font voir les images montrées par Chaplin dans son film Les Temps modernes : celles-ci présentent une analyse particulièrement forte du mode de travail propre au capitalisme industriel, dans lequel machines inanimées et machines humaines sont étroitement intriquées les unes aux autres.
L’excédent engendré par l’exploitation de la force de travail est par définition variable, dans la mesure où il est lui-même le résultat d’une variation. Pour en calculer théoriquement le taux, Marx se sert du modèle de la « journée de travail », la totalité du temps pendant lequel, chaque jour ouvrable (et, comme nous l’avons signalé, au XIXe siècle, les travailleurs manuels sont généralement employés « à la journée », ce qui assure à leur utilisation un maximum de flexibilité), l’ouvrier s’est engagé à travailler, donc à activer sa force de travail sous les conditions qui lui sont imposées par l’entrepreneur. Cette journée de travail est idéalement représentée sous la forme d’un segment susceptible d’être découpé en ses éléments, qui correspondent, selon l’analyse proposée par Marx, à deux périodes de temps distinctes : celle consacrée à du « travail nécessaire » (notwendige Arbeit) et celle consacrée à du « surtravail » (Mehrarbeit, surplus labour). Le travail nécessaire est celui qui est accompli en vue de produire une quantité de valeur équivalente à celle requise pour l’entretien de la force de travail en tant qu’Arbeitskraft : c’est cette valeur qui est effectivement payée par le salaire versé à l’ouvrier en échange du droit d’exploiter sa force de travail, alors même que le résultat de cette exploitation représente une valeur qui n’est pas la même que celle rémunérée par le salaire. Le surtravail correspond formellement à l’autre partie de la journée durant laquelle l’ouvrier accomplit des tâches qui ne sont pas rémunérées par son salaire parce qu’elles produisent une quantité de valeur en excédent par rapport à celle nécessaire à l’entretien de sa force de travail, quantité de valeur qui, en conséquence, représente, dans le cadre de l’accomplissement du procès de travail où est mis en œuvre le Vermögenskraft, l’activité productrice dont l’exploitation dégage un supplément de valeur, Mehrwert. Il ne faut cependant pas perdre de vue que ce découpage de la journée de travail en deux moments, représentés par des sous-segments, qui se succèdent sur une même ligne, n’a de signification qu’en théorie : c’est seulement en vue de calculer formellement le taux d’exploitation de la force de travail qu’il est supposé que, jusqu’à une certaine heure de la journée, l’ouvrier, en accomplissant du travail nécessaire, travaille pour soi-même, et que, au-delà de cette limite, il travaille pour le bénéfice exclusif de son employeur ; en réalité, c’est de la première à la dernière heure, à chaque moment où l’ouvrier active sa force de travail, que son temps se compose dans une proportion déterminée de travail nécessaire et de surtravail entre lesquels la frontière n’est pas nettement discernable ; ceci est rendu possible par le fait que sa force de travail est, à l’insu même du travailleur à qui il est impossible de savoir quand il travaille encore pour lui et quand il ne travaille plus pour lui, simultanément exploitée sous deux faces, en tant qu’Arbeitskraft, dont la valeur est mesurée par la quantité de travail nécessaire pour la produire, et en tant que Vermögenskraft, dont la valeur est mesurée par la quantité de travail qu’elle est susceptible de produire. Ceci dit, c’est sur la base de cette répartition formelle, pour la commodité de sa démonstration, que Marx introduit la distinction capitale entre plus-value ou survaleur absolue (à laquelle est consacrée la troisième section du livre I du Capital) et plus-value ou survaleur relative (à laquelle est consacrée la quatrième section, c’est-à-dire la partie du texte qui a particulièrement intéressé Foucault pour des raison qui demeurent à préciser).
Soit donc la représentation de la journée de travail comme une ligne (orientée, puisqu’elle représente un écoulement temporel parcouru dans un certain sens) divisée en deux parties qui sont censées se succéder :
L’intérêt du capitaliste est de modifier en sa faveur la proportion entre les deux quantités de temps ainsi représentées, dont la première (a), si elle ne lui coûte rien puisque la valeur s’en retrouve intégralement dans le produit dont il garde la propriété, ne lui rapporte rien, alors que seule la seconde représente pour lui un profit, parce qu’il n’a pas eu besoin, pour disposer des biens qu’elle produit, d’investir la quantité de valeur représentée par le règlement d’un salaire. Pour parvenir à modifier en sa faveur le rapport entre ces deux éléments a et b, le capitaliste peut, selon l’explication proposée par Marx, emprunter deux voies : allonger le sous-segment de droite, celui qui l’intéresse parce qu’il lui rapporte, soit en le prolongeant vers l’avant (il produit alors de la plus-value ou de la survaleur absolue), soit en le tirant vers l’arrière, de manière à grignoter sur la longueur du premier segment (il produit alors de la plus-value ou de la survaleur relative).
Concrètement, la première solution consiste à étirer autant que cela est possible la durée de la partie de la journée vitale consacrée à l’accomplissement de tâches productives, en repoussant l’heure où finit le travail : l’ouvrier, au lieu de travailler un temps total de durée x, va travailler pendant un temps de durée x+x’, puis de x+x’+x’’, etc…, par exemple, si on prend 12 h d’activité laborieuse pour donnée de départ, 14h, 16h, 18h, … Cette augmentation tendancielle rencontre cependant une limite naturelle qui est que la journée astronomique a une durée fixe de 24 heures : si le capitaliste pouvait prolonger cette durée au-delà, donc trouver la procédure technique permettant que, au lieu de 24 h, elle dure, pourquoi pas ?, 26 heures, 28 heures, ce qui lui offrirait la possibilité de produire davantage de plus-value absolue, il n’hésiterait pas une seconde à le faire ; mais cette procédure, il ne l’a pas encore trouvée (peut-être y parviendrait-il en envoyant ses ouvriers travailler sur une autre planète sans modifier les conditions de salaire ; mais cela risquerait de lui coûter très cher en moyens de transport, ce qui rendrait l’opération peu rentable). D’autre part, indépendamment de ce butoir à son grand regret infranchissable imposé par les conditions naturelles, la tendance à accroître la production de plus-value absolue rencontre deux limites : d’une part, s’il veut pleinement profiter de la force de travail de l’ouvrier au moins pendant une période correspondant au temps pour lequel il lui a versé un salaire, il faut quand même qu’il concède une période de relâche, de non-travail, consacrée non au loisir improductif mais au repos réparateur, et plus généralement aux gestes d’entretien et de renouvellement de cette force de travail, se nourrir, éventuellement procréer, et dans ce cas disposer d’un peu de temps à consacrer aux enfants, car, si il ne le faisait pas ses capacités seraient vites épuisées (comme l’agriculture intensive peut, au-delà de certaines limites, épuiser le rendement d’un sol), la formule imagée qui énonce que l’ouvrier se tue à la tâche n’ayant plus alors valeur métaphorique ; le capitaliste, qui use de la force de travail, doit tenir compte du fait que celle-ci s’use, et que son pouvoir se dissiperait complètement si n’était pas accordé le temps, fût-ce un minimum, destiné à le régénérer. L’autre limite que rencontre la tendance à accroître la production de survaleur ou plus-value absolue est que l’insatiabilité de l’employeur qui le pousse à aller toujours plus loin dans ce sens, donc à augmenter sans cesse un peu plus la durée du temps de travail, génère, par sa démesure même, une résistance : à un certain moment, les ouvriers à qui on en demande toujours davantage, et qui prennent conscience que trop c’est trop, comprennent qu’il est de leur intérêt de faire front collectivement pour avancer leurs revendications, ce que redoute particulièrement le capitaliste, car, pour que son entreprise d’extorsion de plus-value produise un maximum de rendement, il est indispensable qu’il ait affaire à des travailleurs qui se présentent face à lui un à un, comme des travailleurs individuels, dont il exploite les divisions, et non réunis en groupe, ce qui accroît leur capacité de résistance. Cette résistance, dont les ouvriers prennent l’initiative, présente en outre l’inconvénient, lorsqu’elle revêt une forme collective, de devenir publique : or le capitaliste a horreur de la publicité ! Il ne veut surtout pas qu’on vienne mettre le nez dans ses affaires, qu’il entend mener à sa guise ! Et, ce qui le dérange et l’exaspère particulièrement, lorsqu’elles ont atteint un certain niveau de publicité, les revendications des travailleurs, officialisées, sont inévitablement relayées par des organes ou des appareils publics, et alors surgit l’idée de réglementer par la loi le temps de travail, en particulier de limiter la durée du travail des enfants, une procédure qui, une fois engagée, se propage au travail des adolescents, puis des adultes ; des inspecteurs, qui ne sont pas tous acquis au point de vue de l’entrepreneur, et qui, quelle étroitesse d’esprit de leur part ! quelle candeur !, prétendent n’avoir en tête que d’appliquer la législation en vigueur, se mettent à visiter les ateliers, à faire des rapports, à répertorier des dommages, à distribuer des contraventions, etc., etc., ce qui, au point de vue de l’entrepreneur est insupportable, car il entend, en tant que propriétaire de son entreprise, rester maître absolu chez lui et ne veut pas entendre parler d’un contrôle extérieur sur ses activités. Le long chapitre 8 de la troisième section du livre I du Capital sur « La journée de travail » (chapitre 10 de l’édition française réalisée sous le contrôle de Marx par Joseph Roy) exploite en rapport à ce thème une abondante (et terrifiante) documentation, dont Engels s’était déjà servi pour écrire, en 1845, son livre sur « La situation de la classe laborieuse en Angleterre (d’après les observations de l’auteur et des sources authentiques) », qui est l’un des textes fondateurs de ce qui s’est appelé plus tard « sociologie du travail ». Les polémiques actuelles autour de la question des 35 heures démontrent que ce chapitre des luttes ouvrières n’est toujours pas refermé, et que les entrepreneurs capitalistes n’ont pas renoncé à tirer de l’exploitation de la force de travail un maximum de plus-value ou de survaleur absolue, en déplorant les concessions que le rapports de forces les a obligés à consentir, de très mauvais gré, à ce sujet, avec l’espoir maintenu en permanence de revenir sur elles chaque fois que l’occasion s’en présente, et concrètement d’allonger la durée du travail (à salaire égal bien entendu).
Lorsque la possibilité d’accroître la production de plus-value ou de survaleur absolue est, en dépit de ses tentatives, bloquée, le capitaliste garde celle de se tourner de l’autre côté, donc d’augmenter la longueur du sous-segment b du schéma d’ensemble de la journée de travail en l’étirant, non vers la droite, dans le sens de la production de survaleur ou de plus-value absolue, mais vers la gauche, dans celui de la production de survaleur ou de plus-value relative. Comment s’y prend-il pour y arriver ? Comme il s’y connaît en calcul de coûts, ce qui est sa spécialité, il réalise que cette opération, qui a pour but de réduire au minimum la part de temps consacrée au travail nécessaire, a pour condition que soit diminuée la valeur de la force de travail proprement dite, c’est-à-dire de l’Arbeitskraft rémunérée par le salaire qui paie le travail nécessaire, rien de plus : et, pour cela, il n’y a pas d’autre moyen que de faire baisser le coût général des marchandises, ce qui, automatiquement, entraînera une diminution de la valeur engagée dans l’entretien de l’Arbeitskraft, sans que cette diminution s’accompagne d’une diminution de la quantité de valeur engendrée par l’activité productive en tant que mise en œuvre de la Vermögenskraft. Non seulement cette quantité de valeur ne diminuera pas, mais elle augmentera : il faudra pour cela que la même durée de temps de travail, payée moins cher, crée davantage de valeur, cette diminution et cette augmentation étant strictement corrélatives l’une à l’autre. Autrement dit, pour accroître son profit, le capitaliste va faire fond sur la productivité de la force de travail en tant que « force productive » dont, dans un même laps de temps, la production de plus-value ou de survaleur absolue ayant été provisoirement stabilisée, il va lui devenir possible de tirer une quantité de valeur plus grande, au titre de plus-value ou survaleur relative. C’est cette notion de productivité qui permet de rendre compte du mode de production capitaliste en allant jusqu’à son cœur même, c’est-à-dire ce qui représente son principe vital, son moteur.
La force de travail comme force productive
Que faut-il entendre par « productivité » de la force de travail ? Pour le savoir, il faut revenir sur la notion de « force productive », dont la portée est cruciale à cet égard. De précieux éléments d’explication sont apportés sur ce sujet, dans le Dictionnaire critique du marxismeréalisé sous la responsabilité de G. Labica (PUF 1982), par l’article « force(s) productive(s) » rédigé par J. P. Lefebvre. Par forces productives, Produktivkräfte, au pluriel, il faut entendre l’ensemble des éléments physiques et organiques qui interviennent dans le déroulement du procès de travail : c’est-à-dire à la fois les moyens naturels et artificiels servant à la production et les dispositions corporelles que les travailleurs activent en vue d’employer ces moyens à la fabrication de biens matériels, ce qui est le but final de la production artisanale et industrielle. Lorsque le texte de Marx exploite cette même notion au singulier, Produktivkraft, non d’ailleurs sans un certain flottement sur le plan de la terminologie, il lui fait signifier, non des êtres existants, que ceux-ci soient des matières naturelles, des instruments techniques ou des corps vivants, mais, ce qui est tout autre chose, une capacité dont la force est porteuse en tant que sa réalité est « dynamique » au sens propre du terme, c’est-à-dire représente une « puissance », un Vermögen. La dunamis, au sens aristotélicien (Métaphysique delta, 12), c’est « le principe du mouvement ou du changement quelconque dans un autre être en tant qu’il est autre » ; elle exprime le procès tendanciel et continu à travers lequel ce qui, existant d’abord « en puissance », est destiné, si les conditions sont pour cela réunies, à se réaliser « en acte » : par exemple, lorsque l’art du médecin parvient à transformer un corps malade en un corps sain, ce qui est un changement d’état de ce corps, il le fait en exerçant la « vertu » qui lui est attachée spécifiquement et qui rend cet art dont le médecin dispose agissant. Dans cette perspective, la force est censée représenter la cause à laquelle est imputé un changement : avant que ce changement se soit produit ou ait été produit, elle existe au titre d’une virtualité qui ne se réalise que lorsque le changement est devenu effectif, c’est-à-dire lorsque de la cause ont été dégagés tous ses effets ; la référence à la puissance assigne à cette virtualité une quasi existence, intermédiaire entre être et non-être, et de ce fait marquée par une ineffaçable ambiguïté, pour autant que ce qu’elle « est déjà », elle ne « l’est pas encore », deux formules dans lesquelles le verbe « être » a deux valeurs différentes qu’il confond sous un même terme. Le capitaliste tire le meilleur parti de cette ambiguïté : il paie avec le salaire la force de travail pour ce qu’elle « est déjà », en tant qu’Arbeitskraft, en se réservant le droit de l’utiliser pour ce qu’elle « n’est pas encore », en tant qu’Arbeitsvermögen, que, pour le mettre en œuvre, il entend façonner à son gré. Comme nous l’avons vu, le prodige opéré par le régime du salariat consiste à séparer la force de son action, en créant artificiellement les conditions qui permettent qu’une force puisse être considérée indépendamment de son action, comme si une force qui n’agirait pas, qui ne serait pas agissante, serait encore une force, ce qui, d’un point de vue physique, est, davantage encore qu’un mystère, une absurdité.
Pour un philosophe positif comme Auguste Comte, l’interprétation causaliste de la force et de son action est entachée de présupposés métaphysiques, ce qui rend parfaitement vaine sa prétention à rendre compte objectivement des phénomènes réels dont elle ne propose, au mieux, qu’une description approximative : dire que, si l’opium fait dormir, c’est parce qu’il est doté d’une vertu dormitive qui constitue sa puissance ou sa force propre, de laquelle il tire sa capacité d’agir, ne fait en rien avancer la connaissance, sinon en suscitant de toutes pièces la fiction d’une « vertu » qui disposerait d’une existence indépendante de son actualisation et, en conséquence, la précéderait, en ce sens qu’elle « serait déjà » avant même que celle-ci ne se soit produite, donc sans que celle-ci ait « encore » eu lieu. En conséquence, lorsque la mécanique rationnelle, qui est une branche des mathématiques, ce qui lui épargne l’obligation de se confronter aux données de l’expérience, exploite la notion de « force », et énonce, comme le fait Newton, des lois de l’action des forces, il faut se garder d’attribuer à cette notion une réalité physique, et il faut la maintenir dans le rôle de concept abstrait ou de construction intellectuelle qui a une valeur démonstrative, mais certainement pas une valeur explicative au sens d’une explication causale : énoncer que les forces sont les causes du mouvement qu’elles engendrent, c’est tout simplement ne rien dire du tout ; c’est pourquoi la mécanique renonce à évaluer les forces pour elles-mêmes, et se contente de calculer leur « travail », représenté par leurs effets réels.
A ce point de vue, on pourrait dire que le capitaliste, lorsqu’il tourne son intérêt vers la force de travail de ses ouvriers, qu’il a acquis le droit d’utiliser en échange d’un salaire, en traitant celle-ci comme une « force productive » dont il envisage d’améliorer la productivité, dans la perspective de la production d’une plus-value ou survaleur relative, fait lui-même de la métaphysique, sous une forme non pas théorique mais pratique ; et cette sorte particulière de métaphysique, il la fait, non pendant ses heures de loisir à titre de dérivatif ou de gymnastique intellectuelle, comme il ferait des mots croisés, mais tout le temps de la journée ouvrable consacrée à la production, en faisant franchir les murs de son entreprise à des notions comme celles de « force », de « puissance » et de « cause », ce qui a pour conséquence de les faire passer dans la réalité, de concrétiser ces fictions, ces créations de l’esprit, dont il se sert alors avec une efficacité redoutable : mieux que ne le ferait un philosophe avec des démonstrations abstraites, il démontre ainsi, feuille de paie et organigramme d’organisation des tâches en mains, que, la métaphysique, ça marche on ne peut plus matériellement, à condition qu’on sache la prendre par le bon bout, en la faisant entrer à l’usine. On pourrait, en passant, tirer de là une nouvelle et décapante définition de la métaphysique : dans ce contexte un peu particulier, elle se ramène à un mécanisme qui permet de faire du profit, ce qui n’est tout de même pas rien. Cela veut dire que le capitalisme, entre autres innovations qui ont changé le cours de l’histoire, a trouvé le moyen, le procédé, le « truc », qui permet de faire passer en pratique des concepts abstraits dans la réalité, ce qui est la marque propre de son « génie ».
Qu’est-ce en effet que cette fameuse productivité attribuée à la force de travail en vue de la qualifier, ou plutôt de la requalifier ? C’est la « vertu » ou « puissance » susceptible de lui être attribuée lorsqu’on se met à la considérer et à la traiter matériellement comme une « force productive », au sens d’une capacité à mettre en acte qui, non seulement est mesurable sur le papier, mais peut être modulée, modifiée dans la perspective de son augmentation : tel est en effet l’objectif que poursuit la rationalisation du travail qui, en le soumettant à des normes, et en faisant bouger ces normes, en intensifie la « productivité ». Dans une telle perspective, la norme présente une dimension non seulement constative mais performative : elle ne sert pas seulement à repérer un état moyen qu’elle recense comme « normal », mais elle devient « normative », c’est-à-dire qu’elle exerce une action transformatrice sur la réalité à laquelle elle s’applique, qu’elle appréhende, non telle qu’elle est, mais telle qu’elle peut devenir, si on en améliore les potentialités. C’est ce thème qui avait été abordé par Didier Deleule et François Guéry dans leur petit ouvrage sur Le corps productif (éd. Repères-Mame, 1972), où ils attiraient l’attention sur le fait que ce n’est pas du tout la même chose de traiter la force de travail en tant que force productrice et en tant que forceproductive. Si le capitaliste payait avec le salaire la force de travail en tant que force productrice, cela le placerait formellement dans l’obligation de restituer au travailleur une quantité de valeur égale à celle que produit effectivement son travail : et alors serait vérifiée la thèse de l’économie ricardienne selon laquelle le travail de l’ouvrier est payé à sa valeur réelle. Mais, bien évidemment, une telle chose ne peut intéresser le capitaliste parce que, même si cette opération créait de la valeur, elle ne lui rapporterait aucun profit, ou du moins l’obligerait à partager avec les travailleurs qu’il emploie le surplus de valeur engendré par l’activation de leur force de travail : s’il s’en tenait à l’exploitation de la force de travail de ses ouvriers mesurée en fonction de ses résultats, c’est-à-dire de ce qu’elle produit réellement en termes de valeur, d’une telle démarche ne se dégagerait aucune « croissance » au sens où il l’entend, c’est-à-dire au sens de l’augmentation de la valeur du capital, de « son » capital dont il partage la propriété avec ses actionnaires, les seuls à qui il ait à rendre des comptes au sujet de la façon dont il le gère. C’est pourquoi la force de travail qu’il emploie l’intéresse, au sens fort du terme, en tant qu’elle est, non pas productrice, mais productive, ce qui ouvre la possibilité de la traiter, non comme une force en acte, telle qu’elle « est déjà », mais comme une force en puissance, telle qu’elle « n’est pas encore », comme telle porteuse de virtualités sur lesquelles peuvent être exercés une pression et un contrôle allant dans le sens de leur intensification.
La notion de « travail vivant » accède alors à une nouvelle dimension. Le travail vivant, c’est le travail en tant qu’il est, non seulement producteur, mais productif, c’est-à-dire qu’il met en œuvre une force de travail traitée comme une « force productive », qui produit de la valeur dans des conditions sur lesquelles il est possible d’intervenir en jouant sur les possibilités de transformation dont la vie, en raison de sa plasticité, de son adaptibilité, est créditée. Le thème actuellement très en vogue de la « flexibilité » se trouve au cœur de cette problématique, que maîtrise parfaitement une praticienne de la métaphysique du calibre d’une Mme Parisot, qui fait de la métaphysique sans le savoir, ce qui rend sa « spéculation » particulièrement efficace. Le capitalisme, parce qu’il prend la force de travail comme une force productive, et non comme une force productrice, s’autorise à la traiter avec un maximum de souplesse, car il a tout à y gagner : il rejette avec la dernière énergie les règles que la législation prétend lui imposer, sous prétexte que ces règles rigidifient une réalité qu’il considère, lui, comme vivante, et en conséquence malléable, sur le modèle d’un animal sauvage qu’il s’emploie à dompter, de manière à lui faire exécuter des tours surprenants dont on ne l’imaginerait pas à première vue capable, traverser des cerceaux enflammés, tourner de plus en plus vite dans un cylindre en mouvement, etc., etc.. De ces exercices de haute voltige dont la production capitaliste a fait sa spécialité, ce connaisseur en métaphysique d’une autre classe que Mme Parisot qu’est Charles Spencer Chaplin a donné une visualisation saisissante dans les séquences de son film Les Temps Modernesoù l’on voit son héros, Charlot, entraîné dans les mécanismes de la production industrielle avec lesquels il finit par faire si souplement corps que, malaxé par leurs courroies de transmission, il se fond en eux jusqu’à s’y identifier totalement : il devient visseur accéléré de boulons5, au point de ne plus savoir ni pouvoir rien faire d’autre quand il est sorti de l’usine, ce qui est une manière de faire comprendre que sa « force » ne lui appartient plus dans la mesure même où elle a été séparée de lui. Bien sûr, cet aménagement de ses capacités, qui rend sa force de travail « productive » dans le sens qui convient au capitaliste, a pour effet de créer une nouvelle rigidité, qui le rive étroitement à la fonction qui lui est assignée, fonction qu’il doit remplir selon des normes qui lui sont, au sens fort du terme « fixées », et qu’il est dans l’obligation de respecter. C’est par ce moyen que la souplesse recrée de la rigidité : le capitaliste ne se contente pas d’être métaphysicien ; il est dialecticien, il réconcilie les contraires, ce qui est sa façon à lui de composer les forces qu’il exploite, non seulement en en traçant le parallélogramme, comme le fait le mathématicien, mais en les forçant à rentrer dans le schéma qu’il a établi en fonction de ses intérêts, qui consistent à tirer des moyens de production dont il dispose, y compris les forces de travail de ses ouvriers, un maximum de profit, en particulier en leur faisant produire de la plus-value relative.
Un passage du texte de Marx illustre ce point de manière frappante. Ce passage, qui se trouve à la fin du chapitre 12, « Division du travail et manufacture » (chap. 14 de l’édition Roy), met en évidence le contraste entre la forme que prend la division du travail à l’intérieur de l’entreprise, telle qu’elle s’effectue déjà sous le contrôle du capitaliste manufacturier, donc avant même qu’ait été développé le système du machinisme industriel, et celle qu’elle prend dans le cadre plus large de la société :
« Dans la manufacture, c’est la loi d’airain du nombre proportionnel ou de la proportionnalité qui subsume des masses déterminées de travailleurs sous des fonctions déterminées, au lieu de quoi, dans la société, c’est le hasard et l’arbitraire qui mènent leur jeu bariolé dans la répartition des producteurs de marchandises et de leurs moyens de production entre les différentes branches sociales du travail… La division manufacturière du travail suppose l’autorité inconditionnelle du capital sur des hommes qui ne sont que de simples membres du mécanisme global qui lui est soumis ; la division sociale du travail met face à face des producteurs de marchandises indépendants, qui ne reconnaissent d’autre autorité que celle de la concurrence, de la contrainte que la pression de leurs intérêts réciproques exerce sur eux, de la même manière que dans le monde animal la « guerre de tous contre tous » maintient plus ou moins en vie les conditions d’existence de toutes les espèces. C’est pourquoi la même conscience bourgeoise, qui célèbre la division manufacturière du travail, l’annexion à vie du travailleur à une opération de détail et la soumission inconditionnelle du travailleur partiel au capital comme une organisation du travail qui augmente sa force productive, dénonce tout aussi fortement le moindre contrôle social conscient et la moindre régulation du procès social comme une atteinte aux inviolables droits de la propriété, de la liberté et du « génie » autodispensé des capitalistes individuels. Il est tout à fait caractéristique que les mêmes personnes qui font l’apologie enthousiaste du système des fabriques, ne trouvent rien à dire de pire contre toute idée d’organisation générale du travail social que celle-ci transformerait la société tout entière en une vaste fabrique. »6.
Dans cette page, Marx épingle le paradoxe du discours libéral, qui donne sa trame à l’idéologie bourgeoise : si celui-ci fait l’apologie du laisser faire, de la dérégulation, du non-interventionnisme, c’est pour mieux fonder une théorie de l’autorité, qui prend la forme de « l’annexion à vie du travailleur à une opération de détail et de la soumission inconditionnelle du travailleur partiel au capital comme une organisation du travail qui augmente sa force productive ». C’est donc bien une relation de pouvoir qui sous-tend le traitement de la force de travail comme une force, non seulement productrice, mais dotée d’une dose graduée, et graduellement améliorable, de productivité imposée au travailleur individuel, alors dépossédé de toute initiative quant à la manière dont sa force de travail est employée, à tous les sens du terme exploitée, dans le cadre du système dont il est devenu un rouage. La liberté, ce mot qu’il a sans cesse à la bouche, c’est pour lui exclusivement que le capitaliste la revendique, afin d’en faire un outil d’asservissement des classes laborieuses auxquelles il ne demande pas leur avis, ni a fortiori leur consentement, pour les plier aux normes de productivité dont il a fait, lui, l’apôtre de la liberté, une « loi d’airain ». Aujourd’hui, près de deux siècles après que se soit mis en place, durant la première moitié du XIXe siècle, le régime des fabriques qui a coïncidé avec le déchaînement du capitalisme sauvage, le discours du patronat n’a pas bougé d’un pouce : la liberté, c’est ma liberté à moi, d’où découle le droit illimité d’asservir autrui, condition de la production d’une plus-value ou survaleur sous ses deux formes absolue et relative.
C’est donc bien sur le plan où se déroule concrètement le procès de travail que se met en place, à travers les formes mêmes sous lesquelles le travail est organisé, c’est-à-dire en fait dirigé, un système de pouvoir et d’assujettissement qui concilie miraculeusement les valeurs opposées de la nécessité et de la liberté. Une fois qu’il a aliéné l’usage de sa force de travail en échange d’un salaire, le travailleur s’est comme scindé en deux et devient un sujet divisé, surdéterminé. Pour une part, il reste la personne qu’il est, attachée à son existence corporelle dont il conserve jusqu’à la mort la propriété inviolable, que, souvent, il traîne derrière lui comme un fardeau, car il lui faut la nourrir, la loger, la soigner, la reproduire (en faisant des enfants), tout cela, le plus souvent, à ses frais et sous sa responsabilité, même dans les cas où il ne dispose pas des moyens matériels suffisants pour l’assumer ; pour une autre part, il s’est transformé en un être dont la puissance ne relève plus seulement des exigences conformes à ses conditions propres d’existence parce que son usage, sa mise en œuvre, ont été placés sous la dépendance de règles qui les transcendent, et il est devenu un sujet productif. Il est porteur et détenteur d’une force de travail partagée entre uneArbeitskraft qui lui appartient et dont il a le soin exclusif et un Arbeitsvermögenremodelable à volonté, dont la substance, la Kraft, a été assouplie, flexibilisée, de façon à ce qu’elle puisse être plus étroitement annexée au type de tâche qui lui a été assigné, au niveau de productivité auquel elle doit se conformer. La nécessité dans la liberté : c’est la grande invention du capitalisme. Et, de fait, il fallait y penser, et trouver les procédures concrètes qui permettent de mettre cette idée en oeuvre.
Ce système de pouvoir, qui dissout l’opposition de la nécessité et de la liberté, est d’un type particulier, propre à l’époque de la révolution industrielle, et au type de société que celle-ci met en place, qui est, selon la terminologie utilisée par Foucault, une société de normes : celle-ci suppose une complète redéfinition de la notion même de pouvoir. Car, pour que la chose marche, pour que le miracle dialectique se produise, il faut que la relation qu’elle met en jeu ait cessé de prendre la forme d’un pouvoir surplombant, dont l’autorité consiste en la réalisation d’un ordre extérieur, et revêt en conséquence le caractère d’une contrainte formelle, dont l’action est avant tout répressive et négative. Tout au contraire, et c’est ce qui définit l’entreprise de normalisation en laquelle consiste l’organisation du travail qui en améliore la productivité de manière à accroître la production de plus-value relative, il faut que son intervention, au lieu de se présenter comme un ordre tombé du ciel, adhère au plus près à la réalité vivante, la « force de travail » comme « force productive », sur laquelle elle cherche à exercer son emprise, et qu’elle réussisse à la pénétrer intimement, à la posséder dans son être même. A ce point de vue, elle présente le caractère d’une véritable recréation, qui correspond au passage à une seconde nature.
Sous cette appellation de seconde nature, on range un plan de réalité foncièrement équivoque, ambigu, qui est une nature sans en être une, et présente la caractère paradoxal d’une nature qui ne serait pas « naturelle », donc une nature, non pas donnée telle quelle, mais produite, engendrée, fabriquée de toutes pièces, ce qui la dispose à devenir elle-même « productive », aménageable, transformable, en vue d’être conformée à des objectifs de croissance : issue d’un changement, elle s’ouvre à des possibilités permanentes de changement, d’où ressort un ordre dont la persistance s’affirme sous le principe de la transformation. Il s’agit donc d’une « condition » instable, qui tire sa substance même de son instabilité, en l’absence d’une base ou fondement et d’une fin qui l’assureraient en elle-même dans l’absolu : elle représente le même sous la figure de l’autre, la permanence dans la forme de la nouveauté. La grande métaphysicienne pratique qu’est Mme Parisot pourrait reprendre à son compte la parole de Nietzsche selon laquelle « « l’homme est l’animal dont le type n’est pas encore fixé » (das noch nicht festgestellte Tier) », tout le sens de cette formule se trouvant concentré dans le « pas encore » (noch nicht), qui signale la foncière précarité d’une forme d’existence à la recherche de son accomplissement vers lequel elle ne cesse de tendre précisément dans la mesure où elle n’y parvient jamais. On peut dire que, si l’humain, et avec lui la force humaine de travail dont la mise en œuvre constitue le travail vivant, relève d’une seconde nature, c’est parce que tout dans sa « nature », ou prétendue telle, est potentiellement « second », c’est-à-dire non pas à proprement parler dérivé, mais relevant d’une secondarité absolue, qui ne se réfère à aucune base ou fondement. En arrière de la thématique de la seconde nature, se trouve donc une procédure de désappropriation, qui surmonte l’alternative de l’ordre pur et du pur désordre : elle représente ce mixte incertain, indéfiniment flexible et manipulable, d’ordre et de désordre, prêt à tout moment à basculer d’un côté ou de l’autre, au cours d’un processus à tous les sens du mot sans fin, poursuivant une opération qui fouille, non vers le haut, mais vers le bas, en s’enfonçant toujours un peu plus dans les profondeurs de l’inaccompli, du « pas encore fixé », où l’idée de « productivité » accède à la plénitude de son sens7.
Qu’est-ce qui autorise la seconde nature à se présenter encore comme « une » nature, alors même qu’elle n’est plus « la » nature ou « de la » nature ? C’est le fait qu’elle oriente les comportements humains sans jamais apparaître à la conscience comme le principe qui les dirige, ce qui est la condition principale de son efficacité : elle agit sous les espèces, c’est-à-dire en fait les apparences, de la spontanéité. Appartenir à la seconde nature, c’est vivre une condition forcée en lui reconnaissant les allures de l’évidence, donc en ayant d’entrée de jeu renoncé à s’interroger sur ses raisons d’être, les fins auxquelles elle répond, et les limites déterminées à l’intérieur desquelles ces fins prennent place. C’est en gros ce que Bourdieu a essayé d’analyser sous le concept d’habitus, et Foucault sous celui de discipline. Lorsqu’il avance le concept d’habitus (qu’il définit comme « système de dispositions durables et transposables, structures structurées disposées à fonctionner comme structures structurantes, c’est-à-dire en tant que principes générateurs de pratiques et de représentations qui peuvent être objectivement adaptées à leur but sans supposer la visée consciente de fins et la maîtrise expresse des opérations nécessaires pour les atteindre », inLe sens pratique, éd. du Seuil, 1980, p. 88-89), Bourdieu récuse la tentation de le placer sous l’horizon des doctrines de la « servitude volontaire », qui ont le tort à ses yeux de réinjecter une certaine dose de prise de conscience dans le fait de suivre ou de se prêter à un type de comportement acquis sans même qu’on ait à s’en rendre compte, et qu’on suit de façon machinale, tout naturellement dirait-on, à ceci près que ce « naturel » relève de la seconde, et non de la première nature. Dans un esprit voisin, Foucault refuse de concevoir la discipline comme un ordre ou une incitation descendus de l’âme dans le corps : car c’est sur le seul plan du corps et des puissances qui lui sont reconnues qu’elle se met en place de façon tâtonnante, en s’appuyant sur des stratégies de formation qui, sur le plan de leur fonctionnement, n’obéissent à aucune finalité définie, susceptible d’être appréhendée en conscience. C’est le sens de la définition de la discipline proposée dans la conférence sur « Les mailles du pouvoir » :
« La discipline est, au fond, le mécanisme de pouvoir par lequel nous arrivons à contrôler dans le corps social jusqu’aux éléments les plus ténus, par lesquels nous arrivons à atteindre les atomes sociaux eux-mêmes, c’est-à-dire les individus. Techniques de l’individualisation du pouvoir. Comment surveiller quelqu’un, comment contrôler sa conduite, son comportement, ses aptitudes, comment intensifier sa performance, multiplier ses capacités, comment le mettre à la place où il sera le plus utile : voilà ce qu’est, à mon sens, la discipline. » (DE, éd. cit., t. IV, p. 191)
Lorsque Foucault parle, comme il le fait ici, du « mécanisme par lequel nous arrivons à contrôler… », formule qui paraît confondre les positions occupées par l’analyste du système et par celui qui le fait fonctionner à son bénéfice, et non du « mécanisme par lequel on arrive à contrôler… », ce qui revient à dissocier ces positions, il veut sans doute signaler que l’existence d’un tel système est consubstantiel à ce qu’il appelle par ailleurs « ontologie du présent », au sens d’un présent qui ne peut être que le nôtre, et donc coïncider avec notre époque historique. Justement, sur le plan de notre actualité à laquelle il est strictement adapté comme peut l’être une technologie qui vise à l’efficacité, le mécanisme disciplinaire s’impose sous les apparences du naturel : il ne va pas de soi de le considérer à distance et de le ramener à son principe moteur, ce que Marx, par un tour de force, est cependant parvenu à faire.
En conséquence, être soumis à l’ordre ou au désordre d’une seconde nature, selon les voies propres à une discipline ou à un habitus, cela fait l’économie du rituel de l’acceptation raisonnée et délibérée : mais c’est être plié sans discussion possible à la règle du « c’est comme ça » qui écarte toute perspective de réflexion et de prise de distance génératrices de contestation. Il s’agit donc d’une forme d’assujettissement qui engendre le sujet auquel elle s’applique en le recréant de part en part ab initio, sans lui reconnaître une réalité antérieure, préalable à son imposition, préconstituée. Lorsqu’il fonctionne dans de telles conditions, le commandement surmonte l’alternative de la violence et du consensus, comme Foucault l’explique dans son étude sur « Le sujet et le pouvoir » (1982), où il écrit :
« L’exercice du pouvoir peut bien susciter autant d’acceptation qu’on voudra : il peut accumuler les morts et s’abriter derrière toutes les menaces qu’on peut imaginer. Il n’est pas en lui-même une violence qui saurait parfois se cacher, ou un consentement qui, implicitement, se reconduirait. Il est un ensemble d’actions sur des actions possibles : il opère sur le champ de possibilité où vient s’inscrire le comportement de sujets agissants : il incite, il induit, il détourne, il facilite ou rend plus difficile, il élargit ou il limite, il rend plus ou moins probable ; à la limite il contraint ou empêche absolument ; mais il est bien toujours une manière d’agir sur un ou des sujets agissants, et ce en tant qu’ils agissent ou sont susceptibles d’agir… Gouverner, en ce sens, c’est structurer le champ d’action éventuelle des autres. » (DE, t. IV, p. 236-237)
Le nouveau pouvoir ainsi mis en place est celui qui s’exerce sur des actions, non pas réelles, donc déjà effectuées, mais possibles, dont il anticipe l’exécution en « structurant le champ d’action éventuelle » où elles vont venir prendre place. Ce champ d’action éventuelle est précisément ce qui constitue une seconde nature, dont les « sujets » sont configurés de manière à répondre ce qu’on attend d’eux, sans qu’on aie besoin ni de les persuader, ni de les forcer, car ils sont eux-mêmes des sujets « possibles », cueillis dès leur naissance et formés de manière à être gouvernables, c’est-à-dire, dans la perspective que nous avons adoptée en revenant aux analyses de Marx, économiquement « productifs ». L’homo oeconomicus, dont cette structure effectue l’intégration est une fiction, en ce sens que sa réalité ou sa « nature » a été forgée de toutes pièces, au titre d’une seconde nature ; mais, par la force des choses, cette fiction est devenue réelle à partir du moment où elle est devenue historiquement partie prenante au fonctionnement des mécanismes qu’elle sert aveuglément.
On comprend alors pourquoi Bourdieu et Foucault, de manière convergente, écartent la référence à l’idéologie, qui prétend interposer entre les hommes, leurs dispositions naturelles, et les formes historiques dans lesquelles celles-ci sont exploitées une couche intermédiaire occupée par des représentations idéelles ayant leur siège dans l’esprit : de ce point de vue, la théorie althussérienne de l’interpellation des individus en sujets par l’idéologie ne peut leur convenir, car ils diagnostiquent en elle le retour d’un spiritualisme rampant. Pour eux, la procédure de l’assujettissement se déroule entièrement sur le plan des corps, sous la forme d’une pénétration ou prise de possession qui ne répond à aucun dessein identifiable en propre, et ne suppose le relais d’aucune parole bonne ou mauvaise, parce qu’elle se confond entièrement avec la trajectoire à travers laquelle elle se propage. Et il faut leur concéder que si la procédure par laquelle la force productrice est reconfigurée en force productive trouve sa justification dans une idéologie de la croissance qui en retotalise intellectuellement les effets sur un plan discursif dans la bouche du capitaliste qui a lui-même développé cette procédure peu à peu, sans savoir exactement où il allait, à l’aveugle, cette idéologie, qui intervient après coup, et présente le caractère d’une élaboration secondaire remplissant une fonction justificatrice de recouvrement, n’a, au mieux, qu’une valeur d’accompagnement : elle ne joue directement aucun rôle dans le déroulement de l’opération à travers laquelle s’effectue cette reconfiguration, qu’il n’est pas permis de ramener à un jeu de langage ; ce n’est pas elle qui fait la décision. Pour que fonctionne le régime du salariat, avec le type d’assujettissement qui lui est propre, qui conditionne l’existence du sujet productif, et non seulement producteur, ce ne sont pas des idées et des mots dont l’intervention est requise en première ligne : mais il faut pour cela que se soient mis en place des mécanismes technologiques et institutionnels qui remodèlent de fond en comble le statut des êtres vivants auxquels ce régime s’applique, c’est-à-dire l’ensemble complexe de procédures que Foucault regroupe sous le concept de « bio-pouvoir » : un tel pouvoir s’exerce et produit ses effets à même les allures de la vie que, une fois qu’il en a pris possession, il s’efforce de recréer ab initio. Lorsqu’il embauche des sujets productifs, porteurs d’une force de travail à double face, à la fois Arbeitskraft et Arbeitsvermögen, division qui lui permet d’en extorquer de la plus-value sous ses deux formes absolue, par l’allongement de la durée du travail, et relative, par la diminution du coût des marchandises provoqué par l’augmentation de la productivité, le capitaliste n’a pas besoin d’adopter la posture d’un bonimenteur de foire et de les convaincre par des arguments du bien-fondé de cette division qui se présente à eux, c’est-à-dire aux sujets productifs qu’ils sont devenus, comme un état de fait qu’ils n’ont pas le choix d’accepter ou de refuser. A ce point de vue, Bourdieu a raison de soutenir que leur servitude n’est en rien volontaire, tout simplement parce qu’elle n’a pas besoin, ni même la possibilité, d’être réfléchie comme telle pour être assumée8.
En instaurant la seconde nature dans le cadre duquel la force de travail a été rendue « productive », le capitalisme a en quelque sorte noyé l’idéologie dans l’économie, au sens à la fois du régime de la production matérielle et des recettes qui l’organisent de manière à en tirer un maximum de rendement avec un minimum de perte. L’une de ces recettes est, d’après Foucault le système disciplinaire, qu’il définit ainsi de manière générale :
« Le propre des disciplines, c’est qu’elles tentent de définir à l’égard des multiplicités une tactique de pouvoir qui réponde à trois critères : rendre l’exercice du pouvoir le moins coûteux possible (économiquement, par la faible dépense qu’il entraîne ; politiquement, par sa discrétion, sa faible extériorisation, sa relative invisibilité, le peu de résistance qu’il suscite) ; faire que les effets de ce pouvoir social soient portés à leur maximum d’intensité et étendus aussi loin que possible, sans échec, ni lacune ; lier enfin cette croissance « économique » du pouvoir et le rendement des appareils à l’intérieur desquels il s’exerce (que ce soient les appareils pédagogiques, militaires, industriels, médicaux), bref, faire croître à la fois la docilité et l’utilité de tous les éléments du système. » (Surveiller et punir, éd. Gallimard, 19775, p. 219-220)
Cette économie disciplinaire, Foucault l’indique clairement ici, s’applique, non à des individus pris un à un, mais à de « multiplicités » : et c’est précisément en incorporant les existences individuelles à de telles multiplicités, à de telles « masses », qu’elle parvient à en « économiser » l’usage, d’une façon qui, entre autres économies, permet de faire l’impasse sur des représentations idéologiques ; ces dernières, si elles ont à intervenir, ne le font qu’après coup, lorsque le travail est déjà fait, sans que cela influe sur sa trajectoire, une trajectoire qui, dans le contexte propre à la seconde nature, est déjà toute tracée, avec d’infimes possibilités d’écart, et sans la perspective de la renégocier.
Une telle situation est à première vue désespérante : si, dans le meilleur des cas, elle fait quand même place à une prise de conscience, celle-ci intervient après coup, donc trop tard pour que les données du problème puissent être discutées et renégociées. Cela veut-il dire que la nouvelle figure de pouvoir ainsi mise en place, qui est celle d’un pouvoir horizontal, à ras de terre, insidieux, ne s’avouant jamais comme tel parce qu’il a avantage à se présenter sous le déguisement de l’évidence et de la spontanéité, efface du même coup toute possibilité de résistance ? Non, sous condition cependant de revoir complètement la conception de cette résistance. Cette révision amène à écarter l’idée d’une résistance globale, préméditée, initiée dès le départ à partir d’un centre, et qui, trouvant son assise dans une claire conscience de la situation, tire son efficacité de sa capacité à développer à son propos un discours cohérent dont elle tire sa justification. Pris dans les « mailles » du nouveau pouvoir, qui le saisit si on peut dire à la source, dans le détail de son existence, au jour le jour, le sujet productif n’a plus qu’à s’adosser à des points de résistance dispersés, mouvants, non raisonnés et coordonnés au départ, auxquels l’instabilité de la conjoncture, liée à l’équivoque de la seconde nature qui est un mixte d’ordre et de désordre, ouvre un espace aux frontières indéfinissables. Plutôt qu’en assumant un projet de rupture définitive, répondant à la formule « classe contre classe », dont la thématique idéologique du grand soir fournit une image frappante, d’autant plus frappante qu’elle est coupée de la réalité, le sujet productif trouve le moyen de s’opposer au système dans lequel il est pris dès sa naissance, et qui constitue la clé de son assujettissement, assujettissement qui fait de lui un sujet clivé, en s’engageant dans des luttes partielles, le plus souvent improvisées, qui profitent au mieux des occasions dans lesquelles ce système laisse émerger les équivoques et les contradictions sur lesquelles il est bâti et dont il ne parvient pas à effacer tout à fait la marque. Contre un bio-pouvoir, il n’est de recours, du moins pour commencer, qu’en des bio-résistances qui, sans illusions et avec l’énergie du désespoir, en exploitent autant que possible les failles, remettant à plus tard la synthèse de ces initiatives qui en recentre provisoirement la dispersion, quitte à reprendre à nouveau le problème à son point de départ lorsque d’autres occasions se présenteront. Restent donc à la disposition du sujet productif des stratégies plurielles, dont il ne faut pas qu’il se dépêche de renouer les fils sous forme de programmes d’ensemble, forcément trompeurs s’ils prétendent résoudre définitivement la question à laquelle ils se confrontent, une question dont une vue claire et rationnelle ne se dégage que peu à peu, sans promesse et sans garantie. Le mieux qui reste à faire au travailleur, lorsque celui-ci est pressé de rendre toujours plus de productivité, est de suivre la voie qu’a lui-même empruntée le capitaliste pour installer le régime d’exploitation dont il espère tirer un maximum de profit, c’est-à-dire de procéder par essai et par erreur, à tâtons, de manière à installer peu à peu, face aux technologies de pouvoir qui se sont emparées de son existence même, des technologies de résistance qui, là où cela est possible, s’efforcent de desserrer cette emprise. C’est donc à même le procès de production, là où l’employeur déploie les figures diverses de son autorité, que le travailleur assujetti trouve à lutter et à s’opposer contre cette autorité qui est parvenue à pénétrer les moindres replis de son être. Cette lutte et cette opposition n’ont cependant aucune chance d’aboutir si elles sont menées de façon individuelle : c’est pourquoi elles doivent être reprises en charge par les associations de travailleurs, principalement ce qui s’appelle aujourd’hui les syndicats, qui en organisent les manifestations et les soumettent, à même leur déroulement, à des plans d’ensemble de mieux en mieux concertés et coordonnés, de manière à leur ôter le caractère inabouti auquel elles sont condamnées lorsqu’elles maintiennent leur forme spontanée.
Le nouveau pouvoir et les formes d’autorité développées à même le déroulement du procès de travail
A partir des indications précédentes, il est possible de comprendre les raisons pour lesquelles Foucault s’est particulièrement intéressé aux passages du Capital dans lesquels sont mises en évidence les figures de l’autorité qui adhèrent étroitement au déroulement du procès de travail, et représentent l’avènement d’une nouvelle forme de pouvoir. Il est possible en particulier de relire les quelques pages du chapitre 11 sur la coopération (chapitre 13 de la traduction de Joseph Roy) de la quatrième section du livre I du Capital où sont examinées certaines des modalités particulières sous lesquelles est effectuée l’intégration de la relation de pouvoir au déroulement du procès de travail : le « truc » dont le capitaliste se sert, à la manière d’un magicien, pour surmonter, à son profit, l’opposition de la liberté et de la nécessité.
La condition première de cette intégration est fournie par le rassemblement des travailleurs en un même lieu où ils travaillent, non seulement les uns à côté des autres, mais les uns avec les autres :
« Qu’un nombre important d’ouvriers travaillent dans le même temps, dans le même espace (ou si l’on veut dans le même champ de travail, auf demselben Arbeitsfeld) à la production de la même sorte de marchandise, sous le commandement du même capitaliste, voilà ce qui constitue le point de départ tant historique que conceptuel de la production capitaliste. » (éd. PUF/Quadrige, p. 362)
Ce rassemblement dans un même « champ », où leurs opérations ont à être coordonnées, a une incidence directe sur la façon dont les ouvriers activent leur force de travail :
« Même quand le mode de travail reste le même, l’emploi simultané d’un nombre important de travailleurs entraîne une révolution dans les conditions matérielles du procès de travail. » (id., p. 365)
Suivant la formule proverbiale, l’union fait la force, une force qui ne résulte pas seulement de l’addition des éléments associés mais de leur combinaison qui, en effectuant leur synthèse, crée une nouvelle force dont le potentiel productif est accru à la fois quantitativement et qualitativement :
« De la même façon que la force offensive d’un escadron de cavalerie ou la force de résistance d’un régiment d’infanterie est essentiellement différente de la somme des forces offensives ou défensives que développe chaque cavalier ou fantassin isolé, la somme mécanique des forces de chaque travailleur pris isolément est essentiellement différente du potentiel de force sociale qui se développe, quand un grand nombre de bras oeuvrent en même temps à la même opération indivise, par exemple, quand il s’agit de soulever un poids, de tourner une manivelle ou de venir à bout d’une résistance quelconque. L’efficience du travail combiné ne pourrait être ici produite en aucune manière par le travail particulier, ou alors seulement en un laps de temps bien plus long, ou encore simplement à une échelle minuscule. Il n’est pas question ici d’une augmentation de la force productive individuelle grâce à la coopération, mais de la création d’une force productive qui doit être en soi la force d’une masse. » (id., p. 366-367)
« En comparaison avec une somme d’égale grandeur de journées de travail individuelles isolées, la journée de travail combinée produit de plus grandes masses de valeur d’échange et diminue ainsi le temps de travail nécessaire à la production d’un effet utile déterminé. Que, dans le cas donné, elle détienne cette force productive accrue parce qu’elle accroît les potentialités mécaniques du travail ou parce qu’elle étend sa sphère d’action dans l’espace, ou qu’elle rétrécit le champ spatial de production proportionnellement à l’échelle de la production, ou qu’au moment critique elle libère beaucoup de travail en peu de temps, ou qu’elle attise l’esprit de compétition des individus et tende leurs esprits vitaux ou qu’elle marque les opération analogues d’un grand nombre de travailleurs du sceau de la continuité et de la diversité, ou qu’elle exécute différentes opérations en même temps ou qu’elle rentabilise les moyens de production grâce à leur usage collectif, ou qu’elle confère au travail individuel le caractère de travail social moyen, quel que soit le facteur, la force spécifique de la journée de travail combinée est force productive sociale du travail ou force productive du travail social. Elle naît de la coopération elle-même. » (id., p. 370)9.
En particulier, devenue composante de cette force de masse, la force de travail individuelle a changé de nature, ce qui la rend calculable à l’aide de paramètres différents : elle a cessé d’être cette force-ci ou cette force-là, dont les caractères sont spécifiquement déterminés par l’existence corporelle de celui qui en est le détenteur ; mais elle est devenue, comme cela a été expliqué, de la force de travail, et même de la force de travail social, mesurable en fonction de critères unifiés, ce qui permet de planifier, de rationaliser sa mise en oeuvre, en vue d’en renforcer la productivité, une notion qui s’applique à la force de travail en général, qualifiée socialement, avant de se transmettre aux forces de travail particulières des individus. L’aspect principal de ce changement est constitué par l’apparition de ce que Marx appelle « la journée de travail moyen » : Taylor, à la fin du XIXe siècle, reprendra cette notion en parlant de « la journée loyale de travail », unité de base de son système d’organisation rationnelle du travail. Cette journée de travail moyen est une abstraction, comme « l’homme moyen » de Quételet, car, de fait, elle ne coïncide jamais tout à fait avec l’activité exercée concrètement par aucun des travailleurs individuels réunis sur le même champ de travail, auxquels cette notion sert tout au plus de norme de référence, de programme à remplir, ce qui suppose une certaine marge d’approximation ou d’erreur. Mais cette abstraction n’en est plus tout à fait une pour le capitaliste, pour autant que c’est d’elle qu’il tient compte dans ses calculs en fonction desquels il règle le fonctionnement de son entreprise : en effet, pour lui, le travail n’existe qu’en tant qu’il résulte de l’emploi d’une « force de masse », définie comme telle sur ses registres, et dont, par voie d’autorité, il s’évertue à effectuer la transposition à la réalité dans ses ateliers où les ouvriers sont amenés à travailler ensemble et non séparément, chacun par soi et/ou chacun pour soi.
Remarquons au passage que, indépendamment même des transformations imprimées par la coopération à la consommation productive de la force de travail qui devient alors la « force d’une masse », c’est le propre du type nouveau de société dont la mise en place coïncide avec la révolution industrielle, que Foucault appelle « société de normes », d’accueillir et de traiter ses sujets, si on peut dire, en masse. Grâce à des instruments d’analyse comme les statistiques et le calcul des probabilités, dont l’administration étatique ignorait l’usage auparavant, il est devenu possible d’évaluer des performances collectives à l’échelle, non de cas isolés, mais des grands nombres, et, à partir de là, d’anticiper les évolutions de ces performances, et d’en régulariser le cours, dans la perspective d’une amélioration de leur rendement. Les actions individuelles, au lieu de s’effectuer au coup par coup, de manière désordonnée, sont en quelque sorte attendues, préparées, préfigurées par le système global à l’intérieur duquel elles prennent place, ce qui en infléchit les orientations. L’un des aspects de ce changement est représenté par la mutation des agents producteurs en sujets productifs, ce qui modifie de fond en comble les conditions dans lesquelles ils font leur travail : celui-ci doit alors répondre, sur le plan de ses résultats, à une attente programmée dont ils ont perdu la maîtrise ; les objectifs qu’ils doivent atteindre sont déterminables préalablement au parcours qui a à charge de les accomplir. Ce qui est décisif à cet égard, c’est qu’on s’est mis à raisonner en terme de potentialités susceptibles d’être définies indépendamment de leur mise en œuvre : de façon générale, au-delà même des limites du champ de la production manufacturière ou industrielle, ce sont des « forces » qui sont sollicitées ; ces forces ont le statut de réalités virtuelles, auxquelles sont imparties à l’avance des capacités qu’il ne leur reste plus qu’à actualiser en se conformant aux modèles qui leur sont prescrits.
Dans une société de normes tout est programmé ou est susceptible de l’être : et les comportements de chacun, du fait d’avoir à prendre place dans des processus ainsi modélisés, perdent le caractère d’actions individuelles disposant d’une valeur propre ; ils sont répertoriés, catalogués, formatés en fonction de critères fonctionnels qui échappent à la discussion, et prétendent prévaloir avec le statut de l’évidence ; dans un tel mode de vie collectif, qui est, comme nous l’avons déjà remarqué à propos de la production industrielle, de la métaphysique en acte, on peut dire que, de fait, l’essence précède l’existence. L’ordre mis en place suivant ce type de procédure est des plus contraignants, mais il exerce sa contrainte sous des formes insidieuses, plus douces, précisément parce qu’il prend les sujets auxquels il s’applique à la source, en anticipant leurs conduites, qu’il prépare et mène vers leur but en s’incorporant à leur déroulement : et quand leurs conduites ne satisfont pas aux objectifs qui leur ont été fixés, il les sanctionne en les rejetant, en les mettant hors jeu, sans même avoir besoin de les condamner formellement. On peut parler à cet égard d’un conditionnement par la norme, qui ne revêt plus le caractère d’une obéissance faisant recours à un commandement extérieur, parce qu’il s’est rendu complètement immanent, au titre de ce que nous avons appelé précédemment une « seconde nature », aux processus qu’il influence en les finalisant. C’est de cette manière que se déploie la nouvelle politique des « populations » dont parle Foucault, une politique qui est simultanément, et indissociablement une économie, dans la mesure où c’est sur le plan de l’économie que sont définis en dernière instance les nouveaux enjeux de pouvoir d’où découlent les nouvelles figures de l’assujettissement.
Ces remarques permettent de mieux saisir la portée et les limites du concept de « société disciplinaire » sur lequel Foucault s’est appuyé au départ pour faire comprendre la nature du nouveau type de pouvoir qui se met en place durant la seconde moitié du XVIIIe siècle dans le cadre propre à la société libérale. L’utilisation de cette notion, introduite par Foucault en 1975 dans Surveiller et punir, se heurte sur le fond à une difficulté. Qualifier un type de société de « disciplinaire », est-ce lui imputer un principe organisateur, « la discipline », s’appliquant uniment à l’ensemble de ses aspects, avec pour conséquence qu’il l’a détermine dans son être, et plus précisément dans son « être disciplinaire » ? Cette question est soulevée par Stéphane Legrand dans son étude sur « Le marxisme oublié de Foucault » (in Marx et Foucault, Actuel Marx, éd. PUF, 2004), qui met en garde contre le syncrétisme essentialiste et réducteur de la notion de discipline, sous laquelle Foucault donne parfois l’impression de subsumer des formes d’assujettissement hétérogènes entre elles, qu’il ramène à une unique procédure dont « la discipline » fournirait une fois pour toutes le modèle : « On se demande comment ce même schéma peut servir à produire de l’apprentissage, de la valeur militaire, de la productivité au travail, de la guérison à l’hôpital » (p. 32). On pourrait, dans le même esprit, s’interroger sur la pertinence de la notion de « norme », lorsque celle-ci prétend disposer d’une valeur explicative en soi. Or il est clair que, lorsque Foucault parle de « société de normes », si cette formule a un sens et peut être prise au sérieux ce n’est pas en référence au modèle idéal d’une société de la norme, mais à une réalité d’un tout autre ordre, qui est un jeu complexe et différencié de normes, notion qu’il est dans tous les cas préférable de n’utiliser qu’au pluriel : sans cela, on prend le risque d’imputer aux normes diverses qui, à un moment donné, coexistent, et éventuellement s’affrontent, dans une même formation sociale historique une finalité unique renvoyant au pouvoir propre d’une norme en soi, traitée à la fois comme une essence et comme une cause. Lorsque, dans Surveiller et punir, Foucault parle de « discipline » au singulier (comme il le fait lorsqu’il donne ce titre à la troisième partie de l’ouvrage), il prend précisément ce risque, et même donne l’impression de s’enferrer quand il présente le schéma panoptique, non comme un exemple particulier, mais comme une sorte de modèle universel pouvant être appliqué, à partir du cas spécifique de la prison, à d’autres institutions disciplinaires comme l’armée, l’école, l’atelier, l’hôpital, etc.. Comme celle de norme, la notion de discipline ne peut servir efficacement d’instrument d’analyse qu’à condition de cesser d’être rapportée au présupposé abstrait d’une convergence de ses formes d’application, et d’être orientée au contraire dans le sens d’une interaction de ces formes dans un contexte où leur composition est exposée à être à chaque fois renégociée. De façon analogue, si on présente l’intervention de normes dans l’ordre social en la ramenant à un programme de « rationalisation » formulé en référence au principe d’une raison toute constituée en soi a priori, on gomme du même coup le caractère historique, et en conséquence conjoncturel, de cette intervention.10.
Cette objection d’ordre général n’est pas la seule qu’on puisse faire à la notion de « société disciplinaire ». Si la société de normes n’était qu’une société de discipline, cela voudrait dire que ses mécanismes ont pour unique point d’application les comportements, et plus spécifiquement les comportements corporels individuels, qu’ils auraient pour objectif de réformer en tant que tels. Or, ce qui caractérise une société de normes, c’est justement qu’elle ne traite pas les individus en tant que tels, mais en tant qu’éléments constituant d’ensembles plus vastes, du type de ceux constitués par les populations : c’est au prix de ce déplacement qu’elle s’est rendue en mesure de les « gouverner », au sens très particulier que Foucault donne à cette notion, c’est-à-dire, pour reprendre une formule que nous avons déjà rencontrée, de « structurer leur champ d’action éventuelle ». Lorsque Marx parle du « champ de travail (Arbeitsfeld) », dans le cadre duquel le capitaliste organise, sous son autorité, la production de plus-value ou de survaleur, il vise précisément quelque chose de ce genre : à l’intérieur d’un tel « champ », les ouvriers ont cessé d’exister comme des individus, mais ils sont devenus des sujets productifs, totalement immergés dans la « force d’une masse », c’est-à-dire d’un corps collectif en dehors duquel ils n’ont plus de réalité propre.
Refermons cette parenthèse, et revenons à l’analyse des nouvelles modalités du procès de travail lorsque celui-ci s’appuie sur la consommation d’une force de masse, ce qui permet d’en améliorer la productivité. Grâce à la réunion des forces individuelles en une force de masse, le patron est mis en position d’exercer une mainmise, non seulement sur le résultat du procès de travail, donc sur son produit en tant que travail mort (Werk, work), mais sur son déroulement en tant que travail vivant (Arbeit, labour). Le changement d’échelle provoque ainsi une modification de la nature du travail. L’exploitation/extorsion de la survaleur, qui s’applique au départ au travailleur individuel, obligé à travailler, non pour lui, mais pour un autre, en vient, au fur et à mesure qu’elle s’intègre au déroulement du procès de travail qu’elle « massifie », à s’appliquer au travailleur collectif, qui effectue le travail commun, travail social, dont elle prend alors en charge l’organisation :
« Le commandement du capital sur le travail (das Kommando des Kapitals über die Arbeit) n’apparaissait à l’origine que comme conséquence formelle du fait que le travailleur, au lieu de travailler pour lui, travaillait pour le capitaliste, et donc sous les ordres du capitaliste. En revanche, la coopération de nombreux salariés fait que le commandement du capital évolue et devient une exigence de l’exécution du procès de travail proprement dit, une véritable condition de la production. Les ordres donnés par le capitaliste sur le champ de la production sont devenus aussi indispensables que ceux du général sur le champ de bataille. Tout le travail immédiatement social ou collectif à une grande échelle requiert peu ou prou une direction, dont la médiation assure l’harmonie des activités individuelles, et qui assume les fonctions générales nées du mouvement du corps productif global, par opposition au mouvement de ses organes autonomes. Un violoniste seul se dirige lui-même, un orchestre a besoin d’un chef. Cette fonction de direction, de surveillance et de médiation devient la fonction du capital dès que le travail qu’il a sous ses ordres devient coopératif. En tant que fonction spécifique du capital, la fonction de direction acquiert des caractéristiques spécifiques. » (id., p. 372)
Marx utilise ici, en vue de faire comprendre comment le patron « dirige » l’exploitation de la force de travail, deux comparaisons, que leur rapprochement rend d’autant plus intéressantes, avec, d’une part le général, et, d’autre part, le chef d’orchestre. L’orchestre représente les modalités d’une coopération obéissant en première ligne à des objectifs techniques ; et l’armée celles d’une coopération faisant intervenir une structure verticale, hiérarchisée, qui, en transmettant des ordres, et en contrôlant qu’ils sont effectivement suivis, c’est-à-dire obéis, organise l’action commune. Suivant ces deux modèles, se met en place un système d’autorité cumulant plusieurs fonctions : direction, surveillance, médiation, telles que Marx les énumère dans ce passage. Diriger, c’est la toute première forme de l’autorité, qui consiste à impulser un mouvement en lui prescrivant une orientation unifiée ont il ne doit pas s’écarter : elle met en œuvre un principe de simplification, qui opère la réduction d’un divers à un tout homogène ; la toute première tâche des instrumentistes d’un orchestre, que son chef a à faire respecter, est de jouer ensemble et non chacun pour son propre compte, à sa fantaisie ; sous la direction que lui imprime son général, qui la lui communique à travers ses « ordres du jour », une armée doit marcher « comme un seul homme », sans laisser place à des comportements déviants et en écartant d’avance les récalcitrants ou les protestataires auxquels n’est laissée d’autre initiative que de sortir du jeu, dans lequel ils n’ont plus leur place. Toutefois, cette forme directe de l’autorité, qui s’exerce d’en haut et de loin, ne suffit pas : laissée à elle-même, elle risquerait de rester lettre morte. C’est pourquoi elle a besoin d’être relayée, et en quelque sorte monnayée, distribuée, ce qui suppose, aux côtés de l’instance supérieure, qui donne les ordres en dernière instance, d’instances intermédiaires, qui surveillent leur application jusque dans le détail, en vérifiant que les moindres gestes individuels sont en conformité avec les règles communes et respectent les normes. De ce fait, l’autorité, au lieu de se communiquer uniment du centre vers la périphérie, se déploie à travers les innombrables canaux d’une organisation complexe où elle acquiert une souplesse suffisante pour s’adapter à tous les aspects de l’activité productive sans exception : autrement dit elle se diversifie. Cependant, pour que cette diversification ne dégénère pas en dispersion, et que la souplesse ne devienne pas un facteur de désordre, il faut, en surplus, que la multiplicité des instances intermédiaires qui mettent en œuvre concrètement l’autorité en lui faisant pénétrer les moindres aspects du déroulement du procès de travail ne soient pas laissées à elles-mêmes, mais restent maintenues dans la perspective globale qu’elles ont à servir et dont elles ne doivent pas être détachées : elles sont ainsi ramenées au statut de « médiations » enchaînées les unes aux autres, ce qui fait à nouveau revenir au premier plan le modèle hiérarchisé de l’armée, avec ses aides de camp, ses officiers, ses sous-officiers, ses petits chefs et ses sous-fifres de toutes sortes, qui assurent que le pouvoir, au lieu de résider seulement à sa tête, soit présent en tous les points de l’organisation, même les plus infimes, où il est reproduit, « représenté », au degré que lui assigne sa place à l’intérieur de l’ensemble auquel il participe et dont il est dépendant. Dans une telle organisation, il n’y a pas, d’un côté le pouvoir, et de l’autre, face à lui, les dominés qui lui sont soumis, mais un réseau compliqué dont les maillons intermédiaires, qui pullulent, occupent des positions à la fois dominantes et dominées, où obéir et faire obéir cessent d’être des fonctions alternatives mais se cumulent au point de se confondre, ce qui se traduit par le fait que ceux qui les occupent obéissent en se faisant obéir. De cette façon, les opérations de direction-surveillance-médiation qui permettent d’organiser le déroulement du procès de travail dans le sens de la production d’un maximum de plus-value ou de survaleur relative se fondent dans ce déroulement, qui s’exécute en étant pris de part en part dans « les mailles du pouvoir » dont il ne parvient plus à se dégager. Cette idée est reprise par Foucault sous une forme concentrée dans Surveiller et punir :
« La surveillance devient un opérateur économique décisif, dans la mesure où elle est à la fois une pièce interne dans l’appareil de production, et un rouage spécifié dans le pouvoir disciplinaire. » (SP, éd. Gallimard, 1975, p. 177, p. 206 de la reprise dans l’édition Tel)
Foucault cite alors en note, dans la traduction Roy, la fin du passage du chap. 13 (11 de l’édition originale allemande) du Capital qui vient d’être commenté.
On peut parler à ce propos d’une généralisation de l’autorité, par laquelle, en se propageant, en se répandant, elle devient immanente au processus de sa réalisation auquel elle s’intègre totalement. Or, paradoxalement, cette généralisation, qui obéit au départ à un motif d’homogénéisation, débouche sur une opération de spécification ou de spécialisation qui concède aux instances intermédiaires dont il vient d’être question une autonomie relative :
« Si la direction capitaliste est, quant à son contenu, duale, du fait de la dualité du procès de production à diriger, qui est d’une part procès de travail social en vue de la fabrication d’un produit, et d’autre part procès de valorisation du capital, quant à la forme elle est despotique (despotisch). Avec le développement de la coopération sur une plus grande échelle, ce despotisme (Despotismus) développe des formes caractéristiques. De la même façon que le capitaliste n’est délivré du travail manuel qu’une fois que son capital a atteint un seuil minimal à partir duquel seulement commence la production capitaliste proprement dite, de même, maintenant, il délègue cette fonction de surveillance immédiate et permanente de chaque travailleur, et même de certains groupes de travailleurs, à une espèce particulière de travailleurs salariés. De même qu’une armée a besoin de sa hiérarchie militaire, une masse de travailleurs oeuvrant ensemble sous le commandement du même capital a besoin d’officiers (dirigeants, managers) et de sous-officiers industriels (surveillants, foremen, overlookers, contre-maîtres) qui exercent le commandement au nom du capital pendant le procès de travail. Ce travail de surveillance générale se consolide jusqu’à devenir leur fonction exclusive. » (id., p. 373)11.
Pour mieux coller au déroulement du procès de travail, le commandement exercé par le capital le « suit », en ce double sens qu’il l’accompagne et qu’il le surveille, et ceci point par point, de manière à ce que la pression qu’il exerce soit permanente, et limite au maximum les possibilités d’écart ou de déperdition. La production de masse a donc pour conséquence d’affiner les formes de la division du travail, en isolant parmi celle-ci des fonctions correspondant aux activités non directement productives qui assurent ce rôle d’accompagnement et de surveillance. L’idée de surveillance est, comme Foucault l’a montré, en particulier dans les études qu’il a consacrées aux procédures disciplinaires, consubstantielle au fonctionnement d’une société de normes. A quoi renvoie, concrètement, le fait de surveiller des activités ? Il signifie que celles-ci ne n’ont pas seulement à être contrôlées après coup, sur le plan de leurs effets ou de leurs résultats, mais sont observées à la source, avant même qu’elles n’aient commencé à s’effectuer : un système de surveillance joue un rôle avant tout dissuasif et préventif ; il préfigure les fins qu’il entend faire respecter, et est d’autant plus efficace qu’il n’a pas besoin d’intervenir en acte, sous forme de sanctions ou de condamnations. C’est précisément cette fonction qui est impartie aux personnels d’encadrement, dont l’autorité, précisément parce qu’elle remplit une fonction de surveillance, agit au plus près du déroulement du procès de travail quelle « suit » pas à pas, et même qu’elle précède en l’orientant de manière à ne lui laisser aucune marge de déviation ou d’erreur. Grâce à ces intermédiaires, le commandement du capital se diffuse à l’ensemble du corps productif, à la force de masse du travail social dont il prend intégralement le contrôle en empruntant toute une variété de canaux dont il maîtrise l’organigramme, ce qui est la condition pour qu’il évite de se diluer en se répandant : au contraire, il est d’autant plus fort qu’il emprunte cette multiplicité de voies qui en affinent la distribution.
A terme, cette répartition, qui aboutit à une diversification des tâches de contrôle et de surveillance, s’accomplit avec la séparation du travail manuel et du travail intellectuel, c’est-à-dire du travail qui ne se contente pas de « faire » le travail ou du travail, mais qui lui applique en retour une opération de réflexion ; celle-ci, de la manière dont le procès de travail est organisé, en vue de mettre en œuvre la nouvelle force de masse engendrée par la coopération, s’effectue à la fois dans la distance et dans la proximité, ponctuellement et de manière ininterrompue. Extrait du travail sous ses formes matérielles, c’est-à-dire manuelles, le travail intellectuel, à ses niveaux gradués, se donne les moyens d’intervenir tout le temps et partout. Le premier à s’être extrait du processus proprement dit de la production, c’est-à-dire de la consommation productive de la force de travail, c’est le capitaliste ou le patron qui, depuis son bureau, tire les ficelles, prend les décisions importantes, définit la politique de l’entreprise ; et à sa suite, se sont peu à peu isolés, ou plutôt spécialisés dans le « suivi » du travail des autres, tous ceux dont il a besoin pour que ses ordres soient transmis et correctement appliqués, estafettes, contrôleurs, personnels de sécurité, gardes-chiourmes en tout genre et de tout poil, auxquels il délègue une portion de son autorité de manière à consolider son extension.
On peut parler à cet égard d’une économie du pouvoir, qui est en même temps une économie de pouvoir ; l’autorité devient gérée à la manière d’une force matérielle, ce qui renforce son efficacité, dont l’évaluation a pour critère en dernière instance la production d’un profit maximal. Citons à ce propos un dernier passage du chapitre du Capital sur la coopération, qui en résume les acquis :
« Le travailleur est propriétaire de sa force de travail tant qu’il marchande avec le capitaliste, en tant que vendeur de sa force de travail, et il ne peut vendre que ce qu’il possède, sa force de travail individuelle et isolée. Ce rapport n’est nullement modifié par le fait que le capitaliste achète 1000 forces de travail au lieu d’une, ou qu’il conclut des contrats avec 100 travailleurs indépendants les uns des autres plutôt qu’avec un seul travailleur individuel. Il peut employer les 100 travailleurs sans les faire coopérer. Le capitaliste paie ainsi la valeur de 100 forces de travail autonomes, mais ne paie pas la force de travail combinée des 100. En tant que personnes indépendantes, ces travailleurs sont des individus isolés qui tous entrent en rapport avec le même capital, mais pas entre eux. Leur coopération ne commence que dans le procès de travail, mais dans le procès de travail ils ont déjà cessé de s’appartenir. En y entrant, ils se sont incorporés au capital. En tant que travailleurs coopérants, que membres d’un organisme qui oeuvre activement, ils ne sont plus eux-mêmes qu’un mode d’existence particulier du capital. La force productive que le travailleur déploie comme travailleur social est ainsi force productive du capital. La force productive sociale du travail se développe gratuitement une fois que les travailleurs ont été placés dans des conditions déterminées, et c’est le capital qui les place dans ces conditions. Comme la force productive sociale du travail ne coûte rien au capital, et comme, d’autre part, elle n’est pas développée par le travailleur avant que son travail n’appartienne lui-même au capital, elle apparaît comme une force productive que le capital possède par nature, comme sa force productive immanente. » (id., p. 374)
Ceci nous ramène aux analyses que nous avions présentées au départ. Ce que le capitaliste achète, et règle sous forme de salaire, en application du contrat de travail qui est un échange entre des parties libres et égales en droit, c’est la possibilité d’utiliser dans le cadre spatial de son entreprise et durant un certain temps la force de travail de chaque producteur individuel. Mais ce que, en réalité, il exploite en vue d’en tirer un excédent de valeur qu’il s’approprie intégralement, c’est une force productive globale, qui ne se ramène pas à la somme des forces de travail individuelles, et que, de ce fait, il n’a pas eu à payer. Cette force productive globale, qui, selon les termes employés par Marx, est celle que « le capital possède par nature comme sa force productive immanente », est le résultat propre de la coopération, qui effectue l’insertion des activités individuelles dans le procès de travail collectif tel qu’il s’effectue sous son commandement, conformément à des normes de productivité qui ont littéralement pris possession de ces activités, en les plaçant sous contrôle et sous surveillance. L’autorité qu’il déploie dans ce cadre est légitime, donc inattaquable juridiquement, puisqu’elle s’appuie sur un échange effectué dans les règles sur des bases consenties par les parties contractantes. Et, en même temps que légitime, elle est efficace à son point de vue, dans la mesure où sa mise en œuvre « rend » un excédent de valeur, sous forme de la production d’une survaleur ou plus-value relative, qui constitue son profit propre, en l’absence duquel, à moins d’être un saint, ce qui est peu envisageable, il ne se lancerait pas dans ce genre de démarche qui fait de lui ce que nous avons proposé d’appeler un métaphysicien en acte, qui réunit les conditions requises pour que, dans les faits et non seulement sur le papier, l’essence précède et détermine l’existence. A la limite, on pourrait dire que la production industrielle capitaliste fabrique de l’essence humaine, sous forme de force productive, en vue de l’exploiter.
On comprend à quel point ces analyses ont pu intéresser Foucault, et le conforter dans son effort en vue de développer une nouvelle conception, non juridique, du pouvoir. C’est ce qui permet de remonter jusqu’à ce qu’il appelle son « fonctionnement réel », dont le droit constitue tout au plus l’envers idéologique, c’est-à-dire une représentation décalée par rapport à ce qui constitue son jeu effectif. De cette idéologie, on ne peut cependant dire, dans l’abstrait, qu’elle est purement et simplement erronée, et doit être rejetée à ce titre, comme une illusion qu’il suffirait de dissiper. Car, à sa manière, elle participe au fonctionnement du pouvoir et contribue à son efficacité :
« C’est à condition de masquer une part importante de lui-même que le pouvoir est tolérable. Sa réussite est en proportion de ce qu’il parvient à cacher de ses mécanismes. Le pouvoir serait-il accepté s’il était entièrement cynique ? Le secret n’est pas pour lui de l’ordre de l’abus ; il est indispensable à son fonctionnement. Et non pas seulement parce qu’il l’impose à ceux qu’il soumet mais peut-être parce qu’il est à ceux-ci tout aussi indispensable : l’accepteraient-ils s’ils n’y voyaient qu’une simple limite posée à leur désir, laissant valoir une part intacte – même si elle est réduite – de liberté ? Le pouvoir, comme pure limite tracée à la liberté, c’est, dans notre société au moins, la forme générale de son acceptabilité. » (La Volonté de Savoir, éd. cit., p. 113-114)
Le pouvoir, pour être productif, doit parvenir à s’insérer dans les réseaux qui, en même temps que des biens matériels générateurs de richesses, façonnent les corps qui, laborieusement, fabriquent ces biens en se conformant aux normes qui président à leur fabrication. La condition pour qu’il y arrive est que son action s’effectue en douceur, en évitant d’être réfléchie et reconnue, faute de quoi sa tentative de pénétration se heurte à des pôles de résistance que son avancée, une fois révélée au grand jour, aura du même coup suscités. Pour atteindre ce but, c’est-à-dire pour se faire ignorer, le pouvoir se sert de leurres, au nombre desquels la représentation inversée de son intervention que lui fournit le discours juridique : l’astuce consiste alors à récupérer cette représentation, qui, prise en elle-même ne correspond à rien de réel, pour en faire un élément de la technologie du pouvoir12. Cette opération, qui ramène le droit sur le plan d’une pure représentation déconnectée de tout contenu effectif, et en conséquence négative, ne présente pas un caractère intemporel, mais elle a lieu, précise Foucault, « dans notre société au moins » : c’est-à-dire qu’elle ne doit pas servir à caractériser le pouvoir en général, une notion qui est vide de tout référent matériel, mais le type de société historique qui a fait de la productivité le cœur de son existence, et a développé les formes de « coopération » industrielle qui lui permettent de réaliser cette fin, c’est-à-dire, dirions-nous dans un autre langage, la société capitaliste. Dans celle-ci, les technologies de pouvoir ont revêtu des allures particulièrement fines, ce qui lui a permis, entre autres exploits, de récupérer à son profit le langage du droit, sous lequel elle masque sa démarche effective, qui se joue sur un tout autre plan que celui du droit et de ses interdits : dans d’autres formes de société, comme la société féodale, on peut se demander si le droit n’a été qu’un langage servant à tenir un discours de recouvrement du type de celui utilisé par la bourgeoisie. Le marxisme académique est tombé à pieds joints dans le piège ainsi tendu : il a pris à la lettre le discours du pouvoir élaboré par la société bourgeoise, qui fait apparaître celui-ci comme une « superstructure », dont les ordres tombent d’en haut, alors que, en réalité, ces ordres montent d’en bas, des profondeurs du système où se produit de la valeur. La vérité du pouvoir, « dans notre société au moins », est économique avant d’être politique13 :
c’est ce que, selon Foucault, Marx aide à mieux comprendre, du moins dans les passages de son œuvre où il démonte les « mécanismes » à travers lesquels le capital déploie son autorité sur le travail, en exploitant la force de travail de manière à en améliorer la « productivité ». Or, pour que cela marche, il faut que les sujets eux-mêmes aient été rendus « productifs », grâce à des procédures d’assujettissement appropriées qui sont parties prenantes à la mise en place de la nouvelle économie. Ces procédures complexes d’assujettissement sont associées à la mise en place de la nouvelle forme de pouvoir qui, en surmontant l’alternative de l’individuel et du collectif, effectue un va-et-vient permanent de la sphère de l’économie à celle de la politique, comme Foucault l’explique dans un passage clé de Surveiller et punir, où sont indiquées en note les référence au chapitre 11/13 du Capital sur la coopération et à l’ouvrage de Deleule et Guéry sur Le corps productif :
« Si le décollage économique de l’Occident a commencé avec les procédés qui ont permis l’accumulation du capital, on peut dire, peut-être, que les méthodes pour gérer l’accumulation des hommes ont permis un décollage politique par rapport à des formes de pouvoir traditionnelles, rituelles, coûteuses, violentes, et qui, bientôt tombées en désuétude, ont été relayées par toute une technologie fine et calculée de l’assujettissement. De fait les deux processus, accumulation des hommes et accumulation du capital, ne peuvent pas être séparés ; il n’aurait pas été possible de résoudre le problèmes de l’accumulation des hommes sans la croissance d’un appareil de production capable à la fois de les entretenir et de les utiliser ; inversement les techniques qui rendent utile la multiplicité cumulative des hommes accélèrent le mouvement d’accélération du capital. A un niveau moins général, les mutations technologiques de l’appareil de production, la division du travail et l’élaboration des procédures disciplinaires ont entretenu un ensemble de rapports très serrés. Chacune des deux a rendu l’autre possible, et nécessaire ; chacune des deux a servir de modèle à l’autre. La pyramide disciplinaire a constitué la petite cellule de pouvoir à l’intérieur de laquelle la séparation, la coordination et le contrôle des tâches ont été imposées et rendus efficaces ; et le quadrillage analytique du temps, des gestes, des forces des corps, a constitué un schéma opératoire qu’on a pu facilement transférer des groupes à soumettre aux mécanismes de la production ; la projection massive des méthodes militaires sur l’organisation industrielle a été un exemple de ce modelage de la division du travail à partir de schémas de pouvoir. Mais en retour l’analyse technique du processus de production, sa décomposition « machinale » se sont projetées sur la force de travail qui avait pour tâche de l’assurer : la constitution de ces machines disciplinaires où sont composées et par là amplifiées les forces individuelles qu’elles associent est l’effet de cette projection. Disons que la discipline est le procédé technique unitaire par lequel la force des corps est aux moindres frais réduite comme force « politique », et maximalisée comme force utile. La croissance d’une économie capitaliste a appelé la modalité spécifique du pouvoir disciplinaire, dont les formules générales, les procédés de soumission des forces et des corps, l’« anatomie politique » en un mot, peuvent être mis en œuvre à travers des régimes politiques, des appareils ou des institutions très divers. » (SP, éd. Gallimard, 1975, p. 222-223)
Cette page confirme que, sans qu’il y ait à trancher entre l’hypothèse d’un Foucault (encore) marxiste et celle d’un Marx (déjà) foucaldien, la rencontre entre ces deux analystes du régime moderne de la socialité a eu lieu, de laquelle ressort une nouvelle conception du pouvoir, de l’autorité et du sujet susceptible d’être prise pour base d’analyses ultérieures.
Exposé présenté le 10 mai 2012. Stage de formation des professeurs de philosophie, Lille
– – –
- Cette perspective est voisine de celle adoptée par Stéphane Legrand dans son étude sur « Le marxisme oublié de Foucault » (in « Marx et Foucault », Actuel Marx, éd. PUF, 2004) : « Les concepts fondamentaux de la théorie foucaldienne des relations de pouvoir dans la « société disciplinaire » restent irrémédiablement aveugles si on ne les articule pas à une théorie de l’exploitation et à une théorie du mode de production capitaliste. » (p. 28) On n’ira cependant pas jusqu’à affirmer, comme le fait S. Legrand, que la théorie foucaldienne a été construite en prenant appui sur un « référentiel marxiste » qu’elle s’est employée à occulter : le parti adopté dans la présente étude est de relire Marx à la lumière de Foucault plutôt que d’expliquer Foucault à partir de Marx, en faisant passer du second au premier un rapport de détermination ou de filiation à sens unique. [↩]
- Osons ce rapprochement : de façon analogue, à la messe, lorsque les paroles sacramentelles sont prononcées, le bout de pain devient quelque chose de tout autre. Au fond, le régime du salariat, qui est à la base du mode de production capitaliste, ne fait que transposer le mystère de la transsubstantiation sur un plan profane, en vue de faire un maximum de profit à défaut d’élever les âmes vers le ciel pour leur faire mériter leur salut. [↩]
- De ce point de vue, lorsque Marx introduit dans l’analyse économique la notion de force de travail, il le fait en se référant implicitement à la conception vitaliste de la force, théorisée par Barthez à l’aide de la notion de « force vitale », puis reprise par Bichat, lorsque celui-ci définit la vie par la domination des forces de la vie sur les forces physiques, et la mort par la domination inverse des forces physiques sur les forces de la vie. Dans cette perspective le « travail vivant », c’est le travail comme acte, qui s’affronte à des obstacles naturels qu’il entreprend de surmonter; et le « travail mort », c’est le travail comme résultat, réinvesti dans le donné de la nature au moment où, l’acte s’étant achevé, le mort a ressaisi le vif : le passage du travail vivant au travail mort représente une consommation d’énergie, de type entropique. [↩]
- Dans une note de travail qu’il me communique, Etienne Balibar écrit à ce sujet : « La question qui intéresse Marx, c’est celle de la « disproportion » croissante entre le « travail vivant » et le « travail mort » (ou objectivé), c’est-à-dire le fait que, avec le développement de la « productivité » capitaliste, une quantité toujours moindre de « travail vivant » acquiert la capacité de mettre en mouvement » ou de « ramener à la vie », c’est-à-dire de réactiver, une quantité toujours plus grande de « travail mort ». Ceci peut se lire « positivement » (la force productive de la force de travail ne cesse de grandir) ou bien « négativement » (le travail vivant est toujours plus écrasé par le travail mort) ; évidemment le démiurgisme prométhéen du « socialiste » Marx lie ces deux perspectives comme les moments successifs d’une aliénation et d’une désaliénation. Mais ce qui est surtout intéressant du point de vue de la critique de l’économie politique, c’est de passer au point de vue de la valeur : en réalité, le fond de l’argumentation de Marx sur la production de la survaleur, c’est que le procès de travail opère simultanément sur les deux plans : il « conserve » la valeur des moyens de production (c’est-à-dire qu’il la recrée ou la reproduit), et il « ajoute » une valeur nouvelle (qui, pour une part, mais pour une part seulement, de plus en plus faible, correspond à la reproduction de la force de travail)… La doctrine latente de Marx, c’est l’inversion de l’ordre « logique » de dérivation des concepts : la « survaleur » est en fait la condition de la « valeur » et non l’inverse, puisqu’il n’y a pas (dans le mode de production capitaliste) de reproduction de la valeur des moyens de production par le travail vivant sinon sous la condition d’une production de nouvelle valeur excédentaire. En ce sens, la « fringale » d’accumulation est toujours déjà inscrite dans le processus de « dépense de la force de travail » , et c’est ce que dit la notion de composition organique du capital. » Peut-être pourrait-on aller jusqu’à dire, dans le prolongement de cette analyse, que, dans le mode de production capitaliste, la limite entre ce qui relève de la valeur proprement dite et ce qui relève de la survaleur n’est jamais nettement tranchée, ce qui rend possible de renégocier en permanence leur rapport dans la perspective de ce que le capitaliste appelle, dans la terminologie qui lui est propre, « croissance », c’est-à-dire non pas la croissance en soi, mais la croissance qui sert ses intérêts, avec pour corrélat une exploitation accrue, rendue possible par l’augmentation de sa « productivité », de la force de travail, combiné instable, indéfiniment « flexible », de travail vivant et de travail mort. [↩]
- L’expression argotique « boulonner », pour « travailler », revêt alors toute sa portée. [↩]
- Le Capital, livre I, éd. PUF/ Quadrige, 1993, p. 400-401 [↩]
- La mise en évidence des incertitudes attachées à l’usage du thème de la « seconde nature » soutient l’anthropologie de l’impropre développée par Bertrand Ogilvie dans son ouvrage « La seconde nature du politique – Essai d’anthropologie négative », éd. L’Harmattan, 2012), qui explique comment ce philosophème étonnant se trouve « animé par un mouvement de contestation interne, ou de dénégation, qui qualifie une essence projetant son propre dépassement mais se refusant en fin de compte à sortir de soi, sans pour autant affirmer absolument son immanence » (p. 83). Nous nous proposons ici de montrer comment cette même équivoque traverse le champ de l’économie capitaliste, lorsque celle-ci, en proie au virus de la productivité, se met à traiter la force de travail comme une force « productive », et non plus seulement productrice. [↩]
- Ceci peut être retraduit dans un langage différent : pour les travailleurs exploités, leur conscience de classe ne se déduit pas automatiquement de leur être de classe, dont elle est au contraire, au départ, dissociée. [↩]
- Dans le chapitre de Surveiller et punir consacré aux « corps dociles » (éd. Gallimard, 1975, p. 165-166), Foucault cite en l’abrégeant ce dernier passage du Capital. [↩]
- Sur ce point, Foucault a nettement rectifié le tir dans des interventions ultérieures où il a souligné le caractère « événementiel » de ses analyses, qui les protège contre la tentation de l’essentialisme. Par exemple, dans sa contribution au volumeL’impossible prison coordonné par M. Perrot, il écrit, dans un esprit qu’on pourrait dire derridien : « Il faut démystifier l’instance du réel comme totalité à restituer. Il n’y a pas « le » réel qu’on rejoindrait à condition de parler de tout ou de certaines choses plus « réelles » que les autres, et qu’on manquerait, au profit d’abstractions inconsistantes, si on se borne à faire apparaître d’autres éléments et d’autres relations. Il faudrait peut-être aussi interroger le principe, souvent implicitement admis que la seule réalité à laquelle devrait prétendre l’histoire, c’est la société elle-même. Un type de rationalité, une manière de penser, un programme, une technique, un ensemble d’efforts rationnels et coordonnés, des objectifs définis et poursuivis, des instruments pour l’atteindre, etc., tout cela c’est du réel, même si ça ne prétend pas être « la réalité » elle-même ni « la » société tout entière. Et la genèse de cette réalité, dès lors qu’on y fait intervenir les éléments pertinents, est parfaitement légitime. » (« La poussière et le nuage », 1980, Dits et Ecrits, t. IV, éd. Gallimard, 1994, p. 15) Et, dans la table ronde qui a suivi la présentation de ce texte, il déclare à l’appui de cette thèse générale : « Je ne crois pas qu’on puisse parler de « rationalisation » en soi, sans, d’une part, supposer une valeur raison absolue et sans s’exposer, d’autre part, à mettre n’importe quoi dans la rubrique des rationalisations. Je pense qu’il faut limiter ce mot à un sens instrumental et relatif… Disons qu’il ne s’agit pas de jauger des pratiques à l’aune d’une rationalité qui les ferait apprécier comme des formes plus ou moins parfaites de rationalité ; mais plutôt de voir comment des formes de rationalisation s’inscrivent dans des pratiques ou des systèmes de pratiques, et quel rôle elles y jouent. » (id., p. 26) En d’autres termes, il n’y a de rationalités et de pratiques de rationalisation que régionales et temporelles, relatives à chaque fois à la conjoncture dans laquelle elles jouent, et il n’est pas permis d’élargir automatiquement leur action à d’autres conjonctures. [↩]
- Dans une note de Surveiller et punir (éd. Gallimard, 1975, p. 166), Foucault cite la dernière phrase de ce passage du chapitre du Capital sur la coopération, qui souligne selon lui « l’analogie entre les problèmes de la division du travail et ceux de la tactique militaire ». Plus généralement, il considère que le génie propre (au sens de l’esprit d’invention, ingenium) du capitalisme a consisté à transférer au déroulement du procès de travail les procédures techniques de pouvoir et de commandement préalablement élaborées en vue d’organiser les armées. [↩]
- Une réponse est ainsi apportée à la question soulevée par M. Dean dans son étude « Critical and Effective Histories. Foucault’s Methods and Historical Sociology » : « Comment est-il possible que ce corps sans tête se comporte si souvent comme s’il en avait bel et bien une ? » (cité par Th. Lemke dans son étude sur « Marx sans guillemets », in Marx et Foucault, Actuel Marx, éd. PUF, 2004, p. 15). La société libérale, qui professe la fin des idéologies, pratique l’idéologie sous la forme paradoxale de sa négation et de son absence, ce qui lui permet d’intégrer l’idéologie à son fonctionnement, en ôtant du même coup à celle-ci le caractère d’un discours surplombant, proféré de haut en bas comme venu de la tête. [↩]
- Dans la 4e leçon du cours au Collège de France de l’année 1977-1978 (intitulé général : « Sécurité, territoire, population »), qui avait été publiée à part en 1978 sous le titre « La gouvernementalité », Foucault explique, en se référant à Quesnay et à Rousseau, que « l’introduction de l’économie à l’intérieur de l’exercice politique, c’est cela, je crois, qui sera l’enjeu essentiel du gouvernement… Gouverner un Etat sera donc mettre en œuvre l’économie, une économie au niveau de l’Etat tout entier, c’est-à-dire avoir à l’égard des habitants, des richesses, de la conduite de tous et de chacun une forme de surveillance, de contrôle non moins attentive que celle du père de famille sur la maisonnée et ses biens. » (Dits et Ecrits, t. III, d. Gallimard, 1994, p. 642). Le pouvoir moderne, en transportant la politique sur le plan de l’économie, fait du même coup de l’économie une politique à part entière. [↩]