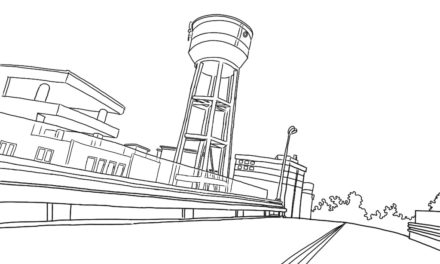di JUDITH REVEL.
Merci aux organisateurs – Christian Laval, Pierre Sauvêtre et Ferhat Taylan ; merci à tous les partenaires qui ont permis cette décade, et merci à Cerisy d’accueillir cette semaine d’échanges autour du commun.
Puisque je suis la première à parler, et qu’il est difficile de tenir le pari de cette position d’ouverture, j’aimerais avant toute chose revenir sur ce presque néologisme que représente le mot « commun », puisque je vous rappelle qu’avant d’être considéré comme un substantif, il a été presque exclusivement un adjectif, s’appliquant, qualifiant, se rapportant à autre chose qu’à lui-même : une chose, un espace, un bien – parfois même une personne – mais semblant paradoxalement n’avoir aucune consistance en lui-même. Je voudrais tenter très rapidement de rendre compte de la pluralité des sens que nous attribuons aujourd’hui au « commun », parce qu’il me semble que le déploiement de cette polysémie – dont les titres des interventions annoncés pour cette semaine sont le reflet : commun substantivé ou adjectivé, commun au singulier ou au pluriel… – permet de saisir deux choses.
La première est évidente, c’est l’extraordinaire foisonnement des usages, qui est lui-même le reflet d’un engouement conceptuel sur lequel on ferait bien de s’interroger : qu’est-ce qui, dans la situation présente, fait de la référence au commun un recours, à la fois contre quoi, et pour décrire quoi ? Je vais revenir sur ce point – je pense qu’il est essentiel de replacer notre mobilisation, ou notre investissement, du commun dans un contexte qui est à la fois économique, social et politique, et qui en détermine très largement à la fois la nécessité heuristique et la puissance politique. Je ne pense pas qu’il y ait seulement un concept philosophique du commun ; je pense en revanche qu’il y a une construction politique de la notion même qui répond à des éléments de contexte dont la nouveauté doit être saisie.
La seconde chose que cette polysémie permet sans doute de comprendre, ce sont en réalité à la fois les jeux de composition et les lignes de tension qui agencent, ou au contraire partagent parfois, un certain nombre d’usages. Il me semble que la question de la compossibilité des références au commun est essentielle, qu’elle fait à sa manière partie de ce que Pierre Dardot, qui parlera dans un instant, désignerait peut-être aussi comme une « stratégie du commun » ; qu’elle est dans tous les cas – cette compossibilité – une condition de possibilité essentielle de la politisation de la question du commun, mais qu’elle n’est pas acquise. De ce point de vue, tenter de comprendre aussi les frictions ou les heurts, ce que j’appelle les lignes de tension, entre différents usages, différentes références, c’est d’une certaine manière faire le pari de composer quelque chose comme un agenda politique du commun.
Le mot, donc.
J’y ai un peu travaillé par le passé, et je ne vais pas redire des choses déjà dites, mais j’ai été frappée de ce que les deux usages que le mot recevait de manière courante, avant même que certains redécouvrent la puissance politique dont il était susceptible, fassent l’un et l’autre, depuis des horizons radicalement opposés, référence à quelque chose de l’ordre de l’invisible ou de l’insaisissable, quelque chose que ne doit pas, ou ne peut pas, être vu.
Bien sûr, le langage de tous les jours attribue au « commun » la caractéristique en général dépréciative de la banalité : ce qui est commun, c’est avant toute chose ce qui n’est jamais reconnu comme objet de désir, ce qui se présente trop souvent et en trop de lieux, ou en trop de mains, pour avoir aucune valeur. Ce trop-plein d’existence est déjà en lui-même générateur d’invisibilité : pourquoi remarquer ce qui se donne partout ? Mais il y a plus intéressant. Dans les maisons bourgeoises, les « communs » ont longtemps été les lieux de la domesticité: tout à la fois l’espace que l’on soustrayait à la vue des éventuels visiteurs (que l’on cantonnait au contraire dans les pièces de « représentation »), l’ensemble des fonctions qui n’avaient pas droit de cité dans le pur théâtre des rapports sociaux (les cuisines, les sanitaires, le garde-manger, la buanderie) et le huis-clos où se retrouvaient tous ceux qui, bien qu’ils assurent le fonctionnement quotidien de l’ensemble de la maisonnée, en étaient paradoxalement les plus durement exclus. Les communs, c’était le domaine de l’ombre, les coulisses d’une scène sociale dont il n’était pas question que la domesticité profite de la lumière, et qui pourtant n’aurait pas existé sans eux. Les communs étaient donc étrangement à la fois l’envers du décor et la condition de possibilité de son fonctionnement.
J’ai, dans d’autres occasions, utilisé la pièce de Jean Genet, Les Bonnes, pour illustrer cette division spatiale et sociale : dans cette pièce, dont je vous rappelle qu’elle s’inspire de l’assassinat par deux domestiques, les sœurs Papin, de leur maîtresse (et de sa fille) dans les années 1930 au Mans, la maîtresse de maison, s’exprime en ces termes (en s’adressant à ses bonnes) : « « Il est vrai que la cuisine m’est un peu étrangère. Vous y êtes chez vous. C’est votre domaine. Vous en êtes les souveraines ». L’assassinat de la maîtresse de maison prend alors, sous la plume de Genet, la forme d’une sorte de révolte des communs, quelque chose comme un renversement, ou un soulèvement, de la division spatiale et sociale que les « communs » supposent. En somme : la révolte des communs a de quoi faire peur – mais elle est ce que la construction de leur invisibilité voudrait paradoxalement effacer. Ne pas voir pour ne pas craindre. Première modalité d’invisibilisation, donc : le déni (sous condition d’une sorte de compression permanente de la révolte).
Seconde modalité d’invisibilisation à présent. Non pas ce que l’on ne doit pas voir, mais ce que l’on ne peut pas voir. Avoir en commun quelque chose, c’est aussi dire ce que l’on pose au fondement d’une coappartenance que l’on reconnaît en général comme sienne. Là encore, l’usage du mot « commun » est intéressant, parce que le commun semble toujours devoir précéder les communautés, en représenter l’assise, la racine immuable, l’essence, la nature. Les communautés se pensent avec difficulté sans le repérage rassurant et préalable de ce qui les rend compactes, homogènes, unitaires; bien souvent même, le « commun » est perçu comme la condition de possibilité absolue de toute coappartenance : il semble impossible d’imaginer une dimension où l’être-ensemble, le vivre ensemble, ne serait pas avant toute chose – logiquement, chronologiquement, ontologiquement – construit sur une ressemblance, un élément partagé, une définition première qui lierait tous les membres de la communauté pour ainsi dire par avance. Le « partagé », c’est précisément le commun de la communauté, ce que ses membres se reconnaissent tous, et qui les unifie. Le partagé, fondateur de communauté, se retrouve donc à fonder la possibilité des partages futurs : et la communauté s’accroit et se renforce dès lors parce qu’elle est déjà enracinée dans un commun qui la justifie.
C’est à la lettre une tautologie, et elle a hanté notre conception du politique et de la politique : la « polis », c’est-à-dire l’intersubjectivité sociale et politique, la possibilité d’un vivre-ensemble, est à la fois l’effet du commun (sans commun, pas de communauté) et sa cause (sans communauté, pas de construction du vivre-ensemble comme mise en commun). Alors on peut bien entendu jouer à être malin, faire du commun des communautés, au fondement des communautés, quelque chose comme un manque (un munus, dit le philosophe italien Roberto Esposito, qui joue sur l’étymologie du mot latin comunitas), reconnaître au fondement de notre réunion cette part toujours manquante que nous aurions paradoxalement en partage, pour retourner la positivité d’un « amont » des communautés en quoi elles soient fondées, ou si vous voulez d’une transcendance positive au fondement de toute communauté, en une transcendance pour ainsi dire négative, évidée, privative. Cela ne change pas grand-chose à l’affaire : c’est toujours d’une transcendance qu’il s’agit, c’est toujours d’un fondement préalable, d’une condition de possibilité absolue et à laquelle il n’est pas prévu que nous ayons accès.
Que l’invisibilité soit incarnée par l’envers soigneusement dissimulé du décorum social (les « communs » comme lieu de la domesticité) ou par l’enracinement lointain du vivre-ensemble dans une définition a priori de ce que nous identifions comme notre essence originelle (le commun comme fondation et légitimation de notre communauté) ; qu’elle soit donc liée à un monde de besognes jugées indignes ou au contraire à une transcendance fondatrice, elle donne dans tous les cas au « commun » sa marque. Le commun est ce que l’on ne saurait voir, ce à quoi l’on ne peut avoir accès : parce que l’invisibilité lui dénie toute consistance. Le commun, d’entrée de jeu, est littéralement barré : il est ce qui se dérobe ou ce qu’on nous dérobe, ou peut-être ce qu’il faut dérober : une absence, un manque, un creux, une ombre. Vouloir penser le commun, c’est presque risquer l’oxymore.
Je crois au contraire que l’engouement que le concept de commun suscite, et la grande quantité de réinvestissements différents auquel il donne lieu depuis quelques années, participe du mouvement contraire : redonner au commun la visibilité de sa propre consistance. Il s’agit, en ce début de XXIe siècle, d’inventer une nouvelle grammaire du politique intégrant précisément le commun dans le régime de la visibilité sociale et politique. Or cela a aussi pour effet de déconstruire un grand nombre de catégories et de clivages, ou de systèmes d’opposition qui ont structuré depuis plus de trois siècles la pensée politique moderne – par exemple l’opposition entre le privé et le public, entre l’individu et la polis, entre le particulier et l’universel, entre les coulisses du monde domestique et le théâtre de la pure représentation sociale, pour redéfinir – en pleine lumière – le commun comme un espace de vie à la fois singulier et partagé, comme invention sans racines mais aux ramages multiples, comme produit de l’action des hommes et non pas comme fondement de leur supposée essence, bref : une nouvelle articulation entre les différences de chacun d’entre nous et l’espace de leur agencement possible.
C’est à partir de ce questionnement que la réflexion politique a, me semble-t-il, largement tenté de se renouveler depuis quelques années. Et c’est sans doute là que les choses se compliquent, parce qu’elle l’a fait essentiellement à partir de cinq grands axes – à la fois distincts et non incompatibles entre eux – dont chacun assignait au commun une définition, une valeur et un type d’enjeux particuliers. Quand je dis non incompatibles, je dis que leur compatibilité est toujours possible. Mais je dis aussi que cette compatibilité ne va pas de soi, et qu’elle doit être construite – c’est-à-dire qu’elle doit résulter d’une décision politique à partir du commun, sur le commun.
Premier champ de déploiement, sur lequel je ne m’attarderai pas puisque d’autres interventions de la semaine en produiront des analyses bien plus précises et que je n’en suis pas spécialiste : il s’est agi de penser, en termes de « biens communs », des ressources naturelles toujours davantage sujettes à risque, dans le sillage d’une prise de conscience de plus en plus généralisée (et de plus en plus nécessaire) des risques écologiques que l’activité humaine faisait désormais encourir à la planète. C’est une histoire qui a désormais un demi-siècle, puisque l’article de Garret Hardin publié dans la revue Science remonte à 1968 ; Hardin y décrit ce qu’il qualifiait comme « la tragédie des communs » et que l’on peut résumer simplement : face à une demande forte, une ressource naturelle limitée demeurée en libre accès est vouée à l’épuisement. L’intérêt de chacun (s’approprier à tout prix une ressource qui lui est nécessaire) est donc contradictoire par rapport à l’intérêt commun (faire en sorte que cette ressource naturelle ne disparaisse pas). Ce qui signifie que soit la ressource est préservée et son accès n’est plus libre –elle perd donc logiquement son statut « commun » ; soit elle demeure commune mais elle encourt une disparition rapide. La tragédie, c’est que le jeu est à somme nulle, et dans tous les cas de figure la conséquence rationnelle du dilemne est un résultat perdant-perdant.
Alors bien sûr, Hardin tendait à assimiler la préservation des biens communs au « bien commun », c’est-à-dire, à la lettre, tout à la fois à la négation des intérêts particuliers et au dépassement de la somme des intérêts de tous ; ce qui l’amenait en réalité à formuler le problème. Mais il le faisait, me semble-t-il, sans jamais sortir de l’opposition intérêt privé/intérêt public, en vertu du paradoxe abyssal qui veut que la gestion publique des communs soit ce qui doit empêcher chacun d’avoir un accès libre aux ressources communes pour que celles-ci puissent être conservées pour tous.
Aujourd’hui, nous savons bien ce par quoi se traduit très souvent la gestion publique et la préservation des ressources naturelles : elle est parfois décisive – je pense au référendum italien sur l’eau de 2011, qui en affirmait le refus de la privatisation et au contraire la nécessaire gestion publique -, mais elle n’est pas résolutive, puisque la nature publique de la gestion n’exclut aucunement que cette gestion se fasse en fixant les prix, c’est-à-dire les conditions économiques d’accès à ces biens, selon les lois du marché (et donc selon le jeu de la libre concurrence) – ce que le Conseil d’Etat italien a de fait entériné en repoussant un certain nombre de recours contre les tarifs publics de l’eau (dont celui de l’Association Acqua bene comune, « Eau bien commun »).
Le débat s’est donc déplacé : au paradoxe de Hardin, il faut sans doute préférer aujourd’hui une formulation en des termes qui ne structurent plus les alternatives possibles autour de l’opposition binaire individuel/collectif, ou privé/public, mais qui cherchent à construire d’autres modes de gestion – qui ne soient précisément ni privés, ni étatiques – des ressources communes. Dans ce contexte, il faut bien entendu penser à l’importance énorme des travaux d’Elinor Ostrom – salués par le Nobel d’économie en 2009, mais là encore, je ne m’y arrête pas, d’autres le feront bien mieux et bien plus justement. Ce sur quoi je me permets cependant d’insister ici, c’est que le renouvellement de la réflexion sur le commun a, je crois, pris son essor dès lors que l’on a déplacé le questionnement du côté des formes d’administration et de gouvernance des biens communs afin de faire sortir le problème du commun de la tenaille privé/public où il semblait s’enferrer. Or cela signifie immédiatement une chose très précise – et j’en viens au déploiement d’un second espace de réflexion, lié au premier.
Cet espace, politique et juridique, consiste à se demander si, dans la notion de « bien commun », ce n’est pas l’idée même de « bien » qui empêche le commun d’être autre chose qu’une sorte de forme paradoxale. Un bien est, techniquement, un objet appropriable – or, précisément, et je parle ici sous le contrôle des juristes, le droit romain, sur lequel tout l’édifice du droit, est encore aujourd’hui fondé, définit comme « commun » ce qui, parce qu’il n’appartient à personne, est appropriable par tous. Ne peut-on au contraire penser le commun indépendamment de l’idée de propriété que le geste d’appropriation (le commun est ce qui est appropriable par tous) porte en soi ? Ne peut-on pas au contraire penser le commun comme ce qui ne peut être approprié (ni individuellement : comme bien privé ; ni collectivement : comme bien public) ? Et, par là-même, ne doit-on pas cesser de définir le « commun » comme un simple prédicat (puisqu’encore une fois, dans le langage courant, « commun » est une forme adjectivale, qu’elle qualifie nécessairement un bien), pour le penser au contraire comme réalité substantive ? Il y a là, me semble-t-il un point essentiel : dépasser l’alternative public/privé, c’est ouvrir à la possibilité politique d’une construction sociale littéralement décrochée du régime de la propriété (qu’elle soit individuelle ou étatique), et c’est aussi tenter de donner une forme à la constitution juridique d’un régime non propriétaire de la participation ou de l’inclusion sociales. Tâche qui signifie au moins en partie notre sortie de la philosophie politique moderne, et qui ouvre à d’autres nécessités encore : je n’ai pas le temps ici de m’attarder sur la manière dont la pensée de la modernité a noué entre eux le travail, la propriété et la citoyenneté. Qu’en serait-il d’une redéfinition non propriétaire de la citoyenneté et du travail ? Je vais y revenir rapidement dans un instant.
Troisième déploiement, troisième déplacement : il concerne l’extension des « communs » par-delà les seules ressources naturelles – sans bien entendu nier l’importance fondamentale de celles-ci. Extension au-delà de ce que nous offre la nature, et qui doit à la fois être préservé et pouvoir être utilisé par tous : parce que ce qui est commun, c’est aussi la totalité de ce que les hommes et les femmes construisent et produisent ensemble (avec l’idée que le résultat de l’activité humaine doit pouvoir être mis à disposition de tous de manière inconditionnelle, littéralement sans condition).
Là encore, on parle en réalité de plusieurs choses.
D’abord : le commun est le produit du travail humain, et à ce titre il n’est susceptible d’aucune appropriation privée ou publique, puisque cette appropriation repose en réalité toujours au mieux sur les présupposés d’un individualisme propriétaire dans les termes même de Locke ; au pire, sur la captation violente, l’arrachement, l’extraction de quelque chose comme de la survaleur. Le problème de l’appropriation du fruit du travail de tous par quelques uns, vieux thème marxien s’il en est, semble par ailleurs connaître une nouvelle jeunesse depuis quelques années, sous une formulation inédite qui est elle-même le reflet d’une mutation profonde du travail : si le travail tend à devenir aujourd’hui toujours davantage cognitif (y compris dans des bassins de production dont la matérialité demeure évidente, mais qui intègrent désormais en permanence des éléments d’information, de langage et des contenus de connaissance), si donc la « privatisation » des acquis de la connaissance représente désormais l’un des enjeux majeurs, en particulier sur la question du brevetage des savoirs et de la propriété intellectuelle, au rebours de cela, le commun, c’est au contraire la volonté de mise à disposition de tous des fruits du travail humain en général – matériel ou cognitif. Je veux insister ici sur un point sur lequel je vais revenir : la remise en cause radicale du système de production capitaliste, qui est de fait entraînée par la réflexion sur le statut non propriétaire des fruits du travail, exige que l’on pense politiquement la nécessité de la désarticulation du lien moderne entre propriété et travail. Il n’exige pas que l’on renonce à la production, ou que l’on doive la limiter : il demande en revanche que l’on repense le travail pour ce qu’il est devenu – c’est, je crois, une différence fondamentale, qui distingue nettement la réflexion sur le commun d’un certain nombre d’autres propositions avancées dans le champ de ce qu’on pourrait appeler de manière générique la décroissance.
C’est d’autant plus vrai que le commun ne concerne pas seulement la question des savoirs brevetables. Il est aussi, et plus généralement, le nom que reçoit ce que la coopération sociale permet de construire (y compris hors des formes du travail salarié : la production déborde ici littéralement les vieilles formes du travail), donc bien sûr la circulation des savoirs, mais aussi les échanges linguistiques et affectifs, et le caractère relationnel des liens sociaux, c’est-à-dire cette innovation permanente dont la valeur est, elle aussi, « captée » par le système capitaliste (en particulier à travers la financiarisation de ses formes). De cela aussi il s’agit de faire un objet de luttes.
Cette « valeur », produite par l’intelligence collective et le tissage toujours plus intense de la vie sociale, est souvent illustrée par l’exemple de la structure de la Toile internet – bien entendu elle ne s’y réduit pas – : elle dit à sa manière la productivité infinie de l’existence en tant que telle, à laquelle il s’agit dès lors de trouver un autre mode d’organisation politique et des institutions nouvelles, en particulier juridiques.
Un bref commentaire sur ce point. Le constat de cette production commune, coopérative et sociale, qui est bien entendu intimement liée au caractère cognitif dont je viens de parler, naît d’études qui, depuis les années 1970, ont tenté de dire l’extension du travail et sa progressive superposition au temps de la vie tout entière – sa biopolitisation, pour reprendre le terme de Foucault ; le changement aussi, qui s’est opéré de l’intérieur même du capitalisme et des processus de valorisation qui permettent la production de survaleur : le passage de l’ouvrier-masse à l’ouvrier-social – et sans doute au-delà, à la figure du travailleur cognitif, a, de ce point de vue, signifié un basculement essentiel qui peut bien entendu être lu à la fois comme un renforcement impressionnant de la subsomption du travail sous le capital – désormais : de la subsomption de la vie tout entière sous le capital ; mais qui peut aussi, et c’est ce qu’il est sans doute important de souligner aujourd’hui, être lu comme ce tournant qui assigne à l’intelligence de la vie sociale, à sa fécondité, à son innovation permanente – en somme : à sa puissance – tout à la fois la fonction de capital variable (ce qu’ont été toujours les hommes dans la relation capital/travail) et désormais celle de capital fixe.
Nouveau paradoxe, nouvelle contradiction, nouvelles conflictualités possibles.
A la place de l’usine, il y a désormais la fabrique sociale dans son entier : la totalité des échanges sociaux est à présent ce qui produit de la valeur – et s’ouvre alors l’espace élargi d’un extractivisme permis, soutenu et organisé dans et par la financiarisation du capital – financiarisation à entendre précisément comme la réponse à la socialisation de la production, comme nouveau visage de la gouvernementalité appliquée à un « social productif » dont elle doit en permanence contrôler les formes et piller la richesse.
Mais précisément pour cela, l’extension du domaine de la subsomption est aussi, à sa manière, la limite extrême du capitalisme lui-même : parce que le principe de sa valorisation suppose aussi toujours, en même temps aussi, l’autonomie et la liberté – relationnelles, créatives, linguistiques, spatiales, coopératives – des individus dont la vie est mise au travail, et dont la valeur est « captée » par le capital. Dire cela ne signifie pas adoucir la réalité de l’aliénation à laquelle les hommes et les femmes sont soumis ; ni nier que certaines des vieilles formes de l’aliénation survivent encore aujourd’hui en dessous, ou aux marges de cela. Cela signifie en revanche se souvenir que le capitalisme est un rapport, et que ce sont les termes de ce rapport qui ont changé. Cela signifie par conséquent désigner la nouveauté comme un espace où faire jouer des perspectives de conflictualité renouvelées. Le commun est aussi, me semble-t-il, le nom de cette nouvelle conflictualité. De ce point de vue, la relative (pas totale, mais sensible) absence des économistes dans cette décade, me semble un peu étonnante – comme si le commun était l’affaire des philosophes et des sociologues (ce qu’il est bien entendu aussi, et fort heureusement) plus que de ceux qui se sont précisément donné pour tâche de dire à quel point le commun est à la fois ce qui est induit par les transformations de la production et, précisément, ce que la réorganisation de la gouvernementalité capitaliste tente d’occulter – par de nouveaux dispositifs, dont la réorganisation du travail est un des aspects fondamentaux, mais qui en déborde très largement le périmètre.
Je voudrais aborder pour finir le quatrième et le cinquième espaces de déploiement de la notion, que j’annonce immédiatement, de peur de ne pas y arriver : le commun comme subjectivation, et le commun comme institution. Ils sont intimement liés à ce que je viens de décrire très sommairement, ils en sont absolument solidaires.
Le commun, ce n’est pas seulement le fruit du travail en ce qu’il devrait être accessible à tous, ou le produit de ce que Marx appelait le General Intellect – l’intelligence collective des hommes et des femmes : c’est également une manière de construire d’autres formes d’existence, c’est-à-dire immédiatement aussi d’autres façons de lutter pour une vie socialement, culturellement et politiquement qualifiée. En ce sens, commun est aussi le nom de la subjectivation qui est à la fois la cause et l’effet de la socialisation de la production. La cause, parce que la relationnalité coopérative et cognitive et les échanges sont des dimensions désormais essentielles de la production ; l’effet, parce que ce qui est directement produit par la production, c’est aussi son propre sujet. Or comme la production déborde les formes classiques du travail salarié et innerve la totalité de l’espace social, cette subjectivation « prend » littéralement, comme l’on dit d’un feu qu’il « prend » (j’emprunte l’image à Merleau-Ponty), dans tous les espaces du social. Le commun comme nouvelle subjectivité politique est un sujet de classe, parce qu’il est engagé dans un rapport de lutte avec le capital ; il est un sujet politique, parce qu’il s’affirme, dans la variété extrême des différences qu’il articule, comme instance de décision et d’organisation, sur la production commune, c’est-à-dire aussi sur la richesse commune et sur le principe d’un accès égal et inconditionné à celle-ci.
D’autres que moi ont avancé, il y a quelques années, le terme de multitude : je crois que le commun en est l’autre visage possible, si l’on envisage la multitude non pas seulement comme un agencement de différences en tant que différences (ou, si vous voulez, et pour le dire vite, comme une alternative au concept moderne de peuple : en somme Spinoza contre Hobbes), mais qu’on la considère comme ce qui est directement produit par le commun – parce que la socialisation de la production entraîne une modification profonde de la subjectivation politique, et qu’à l’inverse, la nouvelle possibilité de subjectivation politique contraint le capital à reformuler les termes mêmes du rapport qui le constitue.
Institution, enfin.
Il me semble que le commun n’a pas besoin d’institutions – non pas parce qu’il faudrait miser sur une sorte de spontanéisme ou d’anarchisme mous, mais parce qu’il est en lui-même une institution, ce qui suppose cependant que l’on se souvienne (et je crois qu’il faut se souvenir) qu’il n’est pas séparable – jamais – de la dimension de la production. Le commun comme institution, c’est l’organisation politique de la production sociale contre le capital, c’est la redéfinition de la production indépendamment de la figure du travail salarié, c’est la nécessité d’un revenu inconditionné pour rétribuer la participation biopolitique à la production sociale commune, c’est la redéfinition sur cette base et dans ces termes d’une nouvelle citoyenneté, et c’est bien entendu la critique radicale de la propriété dans toutes ses formes.
Alors seulement, peut-être, le commun se dira-t-il de modes de vie inédits (mais déjà très largement en voie de constitution), où les cuisines compteront autant que les salons d’apparat, où l’intelligence se dira aussi bien des rapports matériels, de la coopération sociale ou de la production de nouveaux langages ; où les savoirs investiront autant l’abstraction de l’intellect que la construction des affects ou la recherche des plaisirs ; où une nouvelle organisation du vivre-ensemble se donnera à travers une institution incluant en permanence en son sein la possibilité sans cesse relancée de sa propre transformation constituante, c’est-à-dire aussi de la reconnaissance de ce qui la constitue – l’infinie puissance des singularités quand elles s’agencent.
Intervento di apertura della decade di Cerisy, “Le alternative del comune” (9 Settembre 2017)