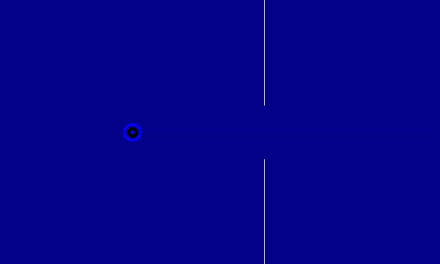Par SANDRO MEZZADRA et FRANCESCO RAPARELLI
1. La pandémie et nous
Au moment où nous écrivons, le virus continue sa course dans de nombreuses parties du monde. En Italie, le rythme des contagions s’est de nouveau accéléré, dans une dynamique qui, bien que de manière différenciée, concerne une bonne partie de l’Europe. De nouvelles restrictions sont adoptées, le cauchemar du confinement se voit sans cesse exorcisé dans le débat public mais il est revenu sur le devant de la scène. Nous savons combien sont puissants les intérêts qui s’opposent à cette mesure extrême, en particulier ceux de qui, comme la confédération patronale Confindustria, avaient déjà montré en mars avec quel cynisme ils faisaient primer la raison du profit sur celle des travailleurs et des travailleuses. Pour « cohabiter avec le virus » nous ne comptons certainement pas sur ces intérêts. Ce sont plutôt les réseaux sociaux, la coopération qui se développe autour d’institutions comme les écoles et les hôpitaux, les formes d’organisation et de protection des emplois, qui peuvent, à nos yeux, garantir une cohabitation efficace avec le virus, capable de maintenir ouverts le plus d’espaces de liberté possible. Il faudra donc dans les prochains mois prendre soin de ces réseaux et de ces formes, les consolider et les étendre. Et il sera tout aussi important d’intensifier la réflexion sur les modalités et les instruments nécessaires pour permettre des luttes et des mobilisations dans cette conjoncture, où l’on ne peut en aucun cas présumer de l’efficacité des formes traditionnelles.
La conjoncture, en attendant, doit être analysée non seulement en termes épidémiologiques mais aussi en termes politiques. Il faudrait le faire selon une perspective globale, la même que celle de la pandémie. Il n’échappe à personne, en effet, que l’enjeu dans la gestion de la Covid-19 concerne également la gestion future du désordre et de l’ordre mondial, comme la course au vaccin le montre par exemple. Le spectre des réactions à la pandémie est du reste très large et profondément hétérogène, et s’étend des schémas gouvernementaux pour l’essentiel « néo-malthusiens », adoptés par des pays comme l’Inde, le Brésil et les USA à des mesures qui visent à « défendre la société » selon une géométrie variable en recourant à l’autoritarisme et à l’utilisation des technologies numériques (si l’on pense à la Chine et la Corée du Sud). Tout en gardant en tête cet arrière-plan mondial, nous voulons tout d’abord nous concentrer sur l’Europe, qui constitue pour nous l’échelle la plus proche de l’action politique. Et c’est là, par ailleurs, que les éléments que nous avons sommairement rappelés sont loin de faire défaut (le « néo-malthusianisme » est notamment bien présent au sein des élites européennes). Il nous semble toutefois que, au sein de la société tout entière et des institutions européennes elles-mêmes, c’est une attitude différente qui prévaut, que l’on peut mesurer à l’aune de la différence entre la réaction face à la crise financière de 2007-2008 (puis face à la « crise des dettes souveraines ») et face à la profonde crise économique et sociale engendrée par le coronavirus.
Simplifions : dans les années 2010, le « management européen de la crise » s’organisa autour de la logique punitive et disciplinaire de l’austérité, dans une continuité parfaite avec l’orthodoxie « ordolibérale ». Aujourd’hui la situation est différente, et certains piliers du néolibéralisme à la sauce européenne (le Pacte de stabilité, l’équilibre financier, les attaques menées contre le modèle social) sont ouvertement remis en question tant sur le plan des politiques monétaires que sur celui des investissements et des dépenses publiques. Entendons-nous bien : il s’agit d’une transition politique contestée et réversible, qui se déroule par ailleurs au sein des classes dominantes, dans la perspective de définir des scénarii de stabilisation capitalistique de la crise. C’est cependant une transition cruciale pour nous également, car elle indique un changement significatif du terrain même où se joue le conflit social et politique. Simplifions encore : dans les prochains mois nous ne serons pas appelés à nous battre contre des « coupes budgétaires » dans les dépenses sociales mais pour attribuer des budgets et établir la manière dont ils seront utilisés. Ce n’est donc pas la « résistance » qui sera à l’ordre du jour mais une bataille offensive pour la réappropriation de parts significatives de richesse sociale.
Il n’y a aucun optimisme dans ce diagnostic. Nous ne pensons pas non plus que la crise, ou l’affaiblissement du cadre macroéconomique du néolibéralisme signifie nécessairement l’éclipse de ce dernier. Nous ne répéterons pas l’erreur des gouvernements « progressistes » latino-américains de la première décennie de ce siècle. Nous avons suffisamment appris que le néolibéralisme n’est pas seulement un ensemble de politiques macroéconomiques mais qu’il est aussi une forme de « gouvernementalité » qui a profondément pénétré nos sociétés dans les dernières décennies en y disséminant la rationalité de la « concurrence », du « capital humain » et de la méritocratie. Ces aspects du néolibéralisme nous accompagneront longtemps et il s’agit de les affronter dans tous les lieux où ils agissent. La logique même de distribution des budgets du Fonds de Relance (ou UE de la prochaine génération) en porte des signes remarquables et certainement la situation sera similaire concernant les programmes nationaux d’investissement qui sont en cours de préparation. C’est un point fondamental que l’on doit garder à l’esprit sur ce nouveau terrain de conflit qui s’est objectivement ouvert.
2. Welfare comme terrain de la lutte
Nous énonçons ici clairement notre thèse : dans la conjoncture européenne et italienne que nous avons sommairement décrite, le welfare se présente comme le terrain de lutte privilégié. C’est la composition même du travail vivant actuel qui justifie cette thèse. Dire welfare signifie dire reproduction sociale, et nous avons appris grâce au mouvement féministe à assumer cette dernière comme prisme essentiel pour déchiffrer l’univers même de la production. Reproduction sociale, ou encore ensemble d’emplois qui s’étend des activités des soins dispensés dans les foyers jusqu’aux activités bien plus complexes des secteurs anthropogéniques par excellence, éducation et santé en premier lieu ; un réseau d’activités et d’emplois trop souvent mal payés et invisibilisés, et malgré cela toujours attribués de manière disproportionnée aux femmes, à travers lesquelles la société se reproduit. Il y a ici une clé pour repenser la coopération sociale dans son ensemble, en mettant en évidence la myriade de conflits et de luttes qui tournent autour du travail des soignant·es mais aussi en valorisant le principe de réciprocité et de partage qui l’innerve. Ces conflits et ce principe constituent une loupe fondamentale à travers laquelle approcher la question du welfare dans ses termes les plus généraux. Ils définissent un premier critère autour duquel élaborer des éléments programmatiques non seulement pour le refinancement du welfare mais aussi pour sa profonde réorganisation.
Il est toutefois nécessaire, à partir du moment où nous identifions la centralité du welfare comme terrain de lutte, de faire quelques précisions préliminaires sur les différentes valeurs que ce terme recouvre. Welfare signifie « bien-être ». La lutte concernant le welfare est donc en premier lieu une lutte concernant le sens du bien-être (ainsi que de la santé et la culture qui est transmise par l’éducation). Mais il faut immédiatement ajouter que le bien-être peut s’entendre de différentes manières, par exemple selon une logique patriarcale d’administration et de gestion depuis le haut, tandis que le welfare a été historiquement associé par exemple à workfare (dans la perspective d’une utilisation du travail comme instrument d’une mise au pas des sujets auxquels on nie la possibilité de décider de leur propre bien-être) et à warfare (avec une référence au lien profond entre État social et « complexe militaro-industriel », notamment aux USA).
C’est un fait du reste bien établi que l’histoire moderne des politiques de welfare, celles que nous pouvons définir comme relevant de l’État social, commence avec les lois sur la pauvreté dont le caractère certainement disciplinaire et souvent violemment punitif, a été illustré par des auteurs classiques, comme Marx et Polanyi, puis par une infinité de travaux. Le spectre du « méchant pauvre », stigmatisé par sa propension à l’oisiveté et à la promiscuité, circule dans toute la littérature sur le « paupérisme » qui, en Europe, accompagne la formation de la société industrielle. Des interventions d’aide se doublent d’interventions policières jusqu’à ce qu’il devienne impossible de les démêler les unes des autres, tandis que l’« hygiène » devient un terrain clé pour le développement de politiques de mise au pas des masses récalcitrantes de pauvres et subalternes. La « question sociale », ensuite, demeure liée à la menace constante constituée par une pauvreté d’un genre nouveau, installée au cœur de la production de richesses, se révélant avec une clarté de plus en plus évidente au cours de la « question ouvrière » du XIXème siècle. Et c’est l’insubordination ouvrière qui, entre 1848 et la Commune de Paris, se traduit par de véritables insurrections, ouvre des espaces d’un genre nouveau dans les politiques sociales, à partir de la législation sur les usines en Angleterre et de la lutte pour la réduction de la journée de travail. Une logique différente prend forme ici, celle des droits sociaux de citoyenneté qui, jusqu’à aujourd’hui, cohabite de manière conflictuelle — au sein des politiques sociales et du Welfare State — avec la logique la plus ancienne qui reste patriarcale, disciplinaire, punitive ou de pur assistanat.
L’État social que nous avons connu dans l’Europe occidentale de l’après-guerre, fortement anticipée par le New Deal rooseveltien, recombine ces logiques sous la pression conjointe des nouvelles exigences liées à la production de masse et la continuité des luttes ouvrières. La centralité de la classe ouvrière dans les nouveaux équilibres se trouve, d’un côté, reconnue, et de l’autre, mystifiée, dans la mesure où le salaire ouvrier est mis en avant comme variable interne au développement du capital (notamment à travers l’expansion de la consommation). La « révolution keynésienne » interprète et soutient avec précision cette transition. Il faut le dire clairement : il n’est pas possible de revenir à cette forme particulière de Welfare State. Toutes les conditions ne sont plus réunies, que ce soit du point de vue de la composition de la classe ouvrière ou de celui de l’organisation du capital et du cadre international au sein duquel cette expérience s’est développée. Nous ne pouvons oublier, par ailleurs, que les mouvements des années 60 et 70 en ont attaqué certains éléments constitutifs (les processus de bureaucratisation liés à un welfare entièrement centré sur l’État, la position subalterne des femmes et le familialisme de fond, l’exclusion des minorités et des migrants).
Donc lorsque nous disons que le welfare représente actuellement un terrain de lutte décisif, nous sommes conscients du fait que les logiques disciplinaires qui ont longuement caractérisé son histoire sont bien présentes aujourd’hui encore. Et nous savons que nous ne disposons pas de « modèle » auquel faire référence, que nous sommes contraints à l’expérimentation et à l’invention.
Mais nous savons aussi qu’au cours de ces années s’est développée une grande richesse de luttes et de pratiques, qui, souvent, se sont référées avec force à la formation de nouvelles institutions, potentiellement capables d’inscrire au sein du welfare le principe de l’auto-organisation sociale, de négocier et contester continuellement les politiques publiques en s’imposant comme de véritables instances du contre-pouvoir. Pour ne citer qu’un seul exemple, les Centres antiviolence, qui se rattachent à une longue histoire d’initiatives féministes commencée au moins avec les conseils des années 60, nous semblent particulièrement significatifs. Nous pensons que c’est de ce point que peut repartir le débat concernant ce que, ces dernières années, nous avons appelé les « institutions du commun ».
Nous savons que la bataille sera longue et que nous devrons nous battre sur de nombreux fronts. Comme nous l’avons dit, le néolibéralisme est bien loin d’être battu, et sur le terrain du welfare, ce serait une erreur de le réduire simplement au démantèlement de l’État social. Si les coupes budgétaires dans la santé et l’éducation ont été une constante ces dernières années, surtout en Italie, le néolibéralisme a également élaboré une série de principes de réorganisation des politiques sociales, qui se sont, par exemple, exprimés dans les « réformes » mises en œuvre par le New Labor de Blair en Angleterre à la fin des années 90.
“New Public Management”, “Private Finance Initiative”, partenariats entre le public et les acteurs capitalistiques privés, augmentation des financements pour la sécurité et les forces de police, ont défini un cadre que nous ne serions pas surpris de voir à nouveau proposé aujourd’hui par certaines personnes en Italie, pas nécessairement de « droite ». Il s’agit d’en être conscient et de déployer avec force d’autres projets soutenus par la matérialité des luttes. Mais de manière encore plus générale, c’est du côté du revenu et du salaire qu’il faut regarder si nous voulons que les investissements dans le welfare ne suivent pas des logiques pures d’assistanat mais aillent plutôt à la rencontre d’une composition d’un travail vivant capable d’imposer la reconnaissance, au moins partielle, de sa propre puissance.
3. Revenu et salaire : deux faces de la même médaille
Il faut dire qu’en Italie nous avons, depuis quelques mois, un privilège et non des moindres : il existe un ennemi. Vous penserez naturellement à Salvini, mais ce serait trop peu, au regard de l’actualité politique aux USA ou en Inde. Nous nous référons plutôt à la Confindustria et à son nouveau leader, Carlo Bonomi. En l’écoutant avec attention, en lisant ses interviews, en suivant ses déclarations, les enjeux de la grande fracture dans laquelle nous sommes plongés apparaît évidente, sans équivoque. L’offensive de Bonomi est constante et à plusieurs niveaux.
En premier lieu, la querelle sur les budgets européens. La polémique contre les subventions a une finalité précise : distribuer aux entreprises, frapper les pauvres pour qu’ils s’activent, au lieu de rester dans leur canapé à ne rien faire, bercés par Maman-État : naturellement l’État n’a rien de maternel lorsqu’il garantit de l’argent à fonds perdu aux grandes entreprises. En second lieu, la cible de Bonomi est le Reddito di Cittadinanza (revenu de citoyenneté). Comme toujours, on culpabilise les chômeurs d’être au chômage, la responsabilité retombe sur l’offre inadaptée et lazy de la main-d’œuvre, sans rien dire du désastre qui touche le tissu de la production italienne qui, pendant des années, a échangé la modération salariale contre des investissements dans l’innovation et la recherche qui sont nuls, jouant la concurrence sur le marché européen et mondial à travers la réduction immodérée du coût du travail. Il n’y a alors pas de quoi s’étonner que, en troisième lieu, la Confindustria s’en prenne avec une rare violence aux salaires. Le sujet concerne la négociation collective, avec les renouvellements qui font de cet automne un automne très chargé en inquiétudes marginales ou en luttes, on ne sait pas bien encore. Mais cela concerne aussi le salaire de manière plus générale, par exemple le minimum légal qui, en Italie, n’existe pas encore.
Budgets et amortisseurs sociaux, Reddito di Cittadinanza, salaire : au-delà de la querelle sur le welfare (et qui s’y rapporte étroitement), voilà les éléments décisifs de l’affrontement, dans les prochains mois et les prochaines années aussi. Il est nécessaire d’approfondir, quitte à devenir rébarbatif.
Pendant trop d’années, l’insistance fondamentale sur le revenu de base a écarté la question salariale. Bien sûr, il s’agissait d’en finir avec la culture du travail, qu’elle soit rouge ou blanche. De fait, en mettant l’accent sur l’élargissement démesuré de la coopération productive, innervée par les technologies de la communication et favorisée par des sujets productifs de plus en plus outillés en formation, compétences et relations. En ayant pour ambition de recomposer des figures du travail très hétérogènes, et cependant hostiles aux identités collectives d’une autre époque. Avec la conviction fort juste que, à travers le revenu de base, on pourrait aussi stopper l’attaque contre le salaire qui, à la fin des années 90, se dessinait par la brèche du travail précaire des jeunes et des femmes, plus que par le début du recours massif à la main-d’œuvre migrante, dans les campagnes, les soins aux personnes, la restauration et, par la suite, la logistique. Tout était correct ou tout du moins presque sans erreur.
Mais aujourd’hui en Italie, le « Reddito di Cittadinanza » existe, dès lors qu’on dispose de très peu de ressources et qu’on accepte un travail, pour autant qu’il y en ait. La pandémie a fait sauter ces conditions, et le Reddito di Cittadinanza s’est doublé d’un revenu d’urgence, mais la nouveauté est là. L’attaque de Bonomi explique les enjeux : en faire un instrument résiduel de soutien de la pauvreté absolue, en accentuant peut-être les politiques actives d’emploi dans les firmes privées, avec de grosses affaires pour les agences de travail intérimaire et les organismes qui spéculent sur la formation professionnelle. Surtout, l’application de cette mesure n’a en aucune manière ralenti l’attaque menée contre les salaires, sous sa dernière forme, imposée dans le débat par la Confindustria : le travail à la tâche. Eh oui, car détacher le salaire des horaires, pour le combiner avec la productivité, signifie reculer dans le temps, au sens de la réaction la plus conservatrice.
Aujourd’hui plus que jamais, à la lumière du débat politique européen et national, la bataille pour le salaire et la bataille pour le revenu doivent être menées conjointement. On ne gagne certainement pas la première sans la seconde, mais le contraire est aussi vrai. Seul un salaire européen minimum, avec des critères adaptés (aligné sur les Pays-Bas et l’Allemagne et non sur les zones spéciales polonaises) peut réduire à néant le dumping salarial qui, au-delà du dumping fiscal, favorise les capitalistes européens et non continentaux. Salaire minimum légal, car la concertation retrouvée entre les acteurs sociaux n’est pas une garantie. Elle ne l’est pas pour les contrats jaunes, comme le montre celui de l’UGL (Union générale du travail) signé avec les multinationales du Food Delivery, et elle ne l’est pas en général. Que la CGIL (Confédération générale italienne du travail) hausse la voix sur les renouvellements de contrat est un bon signe, mais la voie est déjà tracée : au lieu d’augmenter les rémunérations, et pour remplacer les augmentations, on introduit ou on renforce le welfare dans l’entreprise (majoritairement la complémentaire santé), comme cela a d’ailleurs été le cas avec le dernier renouvellement (en 2016) pour les métallurgistes. Et la fragmentation corporative du welfare va exactement dans la direction opposée de celle que nous avons définie jusqu’ici : universaliste et absolument stratégique.
Augmenter les budgets et donc le public visé par le Reddito di Cittadinanza existant, en réduisant à néant les exigences et en favorisant les processus publics (pas forcément étatiques) de formation et de requalification professionnelle : voilà, en Italie, quelle est la bataille fondamentale. Et elle le sera d’autant plus quand, comme le demande la Confindustria depuis plusieurs semaines, le blocage des licenciements sautera. Le croisement de la demande et de l’offre ne se produit pas du fait de la demande de main-d’œuvre de la part des entreprises, et pas uniquement du fait de l’incapacité, pourtant consistante, de ceux qui aujourd’hui ont en charge les politiques actives de l’emploi. Mais si l’on renforce le Reddito di Cittadinanza et qu’on ne fait rien pour diminuer les horaires de travail, le problème reste entier. Le salaire minimum légal (européen) et la réduction des horaires sont l’autre face de la lutte pour le welfare universel et le revenu de base. Parce que c’est aussi à travers la pression sur le salaire, direct et indirect, que les résistances du travail vivant, pour l’instant fragmentées et moléculaires, peuvent aspirer à une nécessaire et, combien urgente, massification.
4. Rompre en négociant, négocier en rompant
La tâche est plus grande que les forces sociales en jeu, il n’y a aucun doute. Les luttes du travail vivant sont effectivement fragmentées et moléculaires, surtout celles du travail précaire et ne bénéficiant d’aucun droit. On dirait une condition ontologique, invariante, contre laquelle le patient défi du syndicalisme social reste démuni. Et pourtant il n’y a pas de raccourci. Il n’y en a d’autant moins dès lors qu’on prête attention à ce qui se passe en Europe. Le Recovery Fund, pour la première fois depuis la naissance de l’UE, distribue des budgets conséquents qui, nécessairement, devront relancer les dépenses et l’emploi public. Nous l’avons déjà dit : les formes de la distribution continueront à être celles qui font l’Europe néolibérale, mais les quantités sont inédites, elles ont la consistance d’un Plan Marshall continental.
La nouveauté impose un changement de rythme. Parce qu’elle affaiblit également les populismes nationalistes et semble consolider les nombreuses variantes de la Grosse Koalition allemande [CDU+SPD ou CDU/SPD+ Verts]. Certes, l’Europe ne sortira pas indemne du résultat des élections américaines, où persiste en revanche une guerre civile (pas tant) larvée. Mais elle a certainement emprunté une nouvelle voie pour le moment. Et le traitement européen de la crise dans laquelle nous sommes plongés, qui s’ajoute à la crise ayant explosé entre 2008 et 2012 et qui l’aggrave, ne nous assure aucun happy end, bien au contraire.
On en voit les signes tangibles dans la violence inhumaine que l’Europe dissémine à ses frontières, externalisées en grande partie en Turquie et en Afrique du Nord, avec les boucheries de la Lybie et de la Méditerranée, pour finir à Lesbos. Simplement, nous le répétons, c’est un autre terrain, constitué de politiques monétaires et fiscales qui ne se cachent pas tant que ça d’être keynésiennes. Ce nouveau terrain sera-t-il perméable aux poussées from below [d’en bas] ? Comme toujours, il ne s’agit pas de bonne volonté, mais de rapports de force. Et la question devient donc : de quoi doit être composée la force, pour être efficace ? Il ne suffit pas de réaffirmer ce que nous savons déjà, à savoir que sans lutte il n’y a pas de réforme du capital. La rupture, et seule la rupture, peut rouvrir les jeux. Mais cette dernière ne se produit pas avec l’injonction répétitive, qui tout au plus se met à ressembler de plus en plus à un genre littéraire, utile pour libérer les frustrations et, en même temps, se donner des airs. Ce sera le clinamen qui déterminera, comme toujours, la capacité de saisir l’occasion. Et l’attente messianique, cependant, ne brille plus par son extrémisme bavard. Le problème qui importe, pour nous, est de comprendre ce que signifie aujourd’hui une politique subversive, dans la grande fracture imposée par la pandémie, dans le « cataclysme de l’emploi » qui emmène l’Europe vers un réformisme timide.
Il faut des luttes sociales exemplaires qui puissent durer dans le temps, capables de combiner rupture et négociation. Contre-pouvoirs ou institutions autonomes : qu’on les nomme selon la convenance. Il suffit qu’on s’entende sur le fait qu’il s’agit d’un pouvoir qui diffuse, fondé sur la multiplicité, qui ne peut éluder le point crucial de la convergence. Il ambitionne de consolider une normativité différente, mais ne dédaigne pas une réforme législative conquise sur le terrain. Il a les jambes bien plantées sur la scène extraparlementaire, mais il considère qu’il est tactiquement juste de conditionner par les luttes les aspirations institutionnelles de proximité (nationales et continentales). Allons droit au but : un contre-pouvoir qui ne dure pas dans le temps, et qui n’est pas capable de négocier, n’en est pas vraiment un. Il peut, tout au moins, sans plus le dire, aspirer à la « prise de pouvoir », même sans aucun réalisme politique.
L’institution autonome aujourd’hui s’affirme de plus en plus comme une démocratie d’une autre nature. Non seulement parce que la démocratisation du welfare, comme nous l’avons indiqué, et comme le mouvement féministe l’a clarifié une bonne fois pour toutes, est un passage obligé pour que le
Welfare ait un avenir. Mais aussi et surtout parce que le néolibéralisme, désormais condamné, a cependant détruit en quarante ans la démocratie libérale, et avec elle les dispositifs d’un gouvernement social-démocrate quant à la main-d’œuvre et au conflit social. Consolider mutualisme et solidarité dans les territoires urbains, réinventer (en combattant sans cesse) le droit du travail et le droit syndical, multiplier les expériences de formation autogérée : ce n’est pas la rupture qui est nécessaire, mais le milieu, pour que la rupture soit moins improbable, pour que celle-ci, après avoir explosé, ne devienne pas évanescente et inefficace. Une « longue marche », certainement pas progressive, toujours exposée à la contingence et par conséquent incapable de faire face à la conjoncture, mais bien plutôt longue et accidentée.
5. L’Europe pour nous
Que l’Europe soit ou non l’espace politique où mener la bataille, c’est désormais un problème absolument incontestable. Nous l’avons précisé jusqu’ici, le Recovery Fund tourne la page, la monnaie unique s’accompagne de la mutualisation de la dette et dans la perspective d’une politique fiscale effective, les amortisseurs sociaux et le welfare des différents États membres tendent de plus en plus à s’uniformiser. Et nous avons présenté notre façon de voir les institutions autonomes, en ayant par ailleurs la chance de les pratiquer, quotidiennement, comme de nombreuses personnes. Ces institutions autonomes offrent un premier critère pour penser l’action politique en tant que telle dans l’espace européen. Quelles peuvent être, cependant, les formes d’organisation et de lutte adaptées à l’espace politique européen, c’est la question sur laquelle nous nous échinons à écrire. On s’échine en général, imaginez donc en période de pandémie, avec la deuxième vague qui nous touche déjà durement et qui rendra toute mobilité très difficile. Et pourtant nous ne voulons pas fuir nos responsabilités, car la théorie politique, même si elle prévoit toujours des espaces vides que seule la pratique peut remplir, est de toute façon elle aussi une pratique. Craintive et inoffensive, si elle s’avère incapable d’hasarder, et procédant naturellement par essais et erreurs. Nous concluerons donc cette intervention sur quelques considérations concernant les sujets de l’organisation et des formes de lutte.
Organisation. Nous réaffirmons ce qui a déjà été dit et écrit au cours des derniers mois : les plateformes qui ont accompagné notre vie à distance sont souvent un cauchemar, si l’on pense au Smart Working qu’aucun droit ne protège et à l’extraction constante de données qu’elles rendent possible, mais elles sont bien sûr un instrument utile pour relancer la discussion européenne. Il faut un effort choral, dès le départ : la proclamation de la part de tel ou tel autre noeud territorial ne suffit pas, c’est plutôt un appel immédiatement transnational qui s’avère nécessaire. Il est évident que les bases solides de soutien n’existent pas, mais il y a certainement des relations qui se sont développées au cours des années. Ensuite, l’urgence d’un nouveau départ des mouvement européens est bien entendu partagée. Ce commencement ne sera pas un produit de laboratoire, il exige des brassages vivants, des exemples et des faits concrets. Sans aucun doute le mouvement féministe et le mouvement écologiste ont déjà fait preuve d’une force connective, capable de converger dans le discours et les pratiques de lutte, avec une puissante rapidité mimétique. Les mouvements et les luttes des migrants et migrantes, se déploient ensuite souvent en un espace riche en connexions transnationales La formation d’une civil fleet (flotte civique) pour les secours en mer constitue un exemple de coopéation européenne depuis le bas, d’autant plus important à un moment où repart l’initiative de la Commission européenne en Méditerranée, sous le signe de l’intensification des expulsions et de l’externalisation à venir des contrôles frontaliers. Nous ne partons pas de zéro, en somme. Recovery Fund for the People pourrait être le slogan permettant de mettre en place des mobilisations décentralisées avec des niveaux au minimum semblables et convergents de coordination.
Formes de lutte. Il y a ensuite un point sur lequel il convient d’être clair. Agir dans l’espace politique européen ne signifie pas nécessairement manifester à Buxelles ou lancer des campagnes européennes. Ces deux actions peuvent être utiles et parfois nécessaires, mais c’est peut-être plus important en ce moment de comprendre que les luttes isolées dans un contexte local et national, peuvent avoir un caractère immédiatement européen. Une bataille victorieuse pour l’orientation des budgets du Recovery Fund dans un pays comme l’Italie, aurait des répercussions sur tout le continent, en renforçant des mobilisations analogues ailleurs. Un mouvement comme celui des Gilets jaunes en France, qui a entre autres mis en avant le problème de la lutte pour le salaire, a produit des résonances bien au delà des frontières nationales (et a de plus ouvert un front sur les politiques budgétaires dont les effets ne peuvent que se répercuter sur les politiques européennes elles-mêmes). Une action pour saisir et exalter la dimension européenne des luttes individuelles, des campagnes et des mouvements, doit en somme se doubler de l’engagement pour construire et renforcer des processus de coordination au niveau transnational.
Les occasions de conflit et de mobilisation sur les différents fronts que nous avons ici indiqués ne manqueront pas, dans les prochains mois, en Italie comme ailleurs en Europe : de la question du revenu et du salaire aux décisions concernant la destination des fonds européens. Tout ceci se produira dans une situation fortement conditionnée par la pandémie, où nous rencontrons une difficulté de fond à pratiquer les formes de lutte traditionnelles, notamment en ce qui concerne les actions de masse dans l’espace public. Bien entendu, le formidable cycle de mobilisations autour du slogan Black Lives Matter aux USA montre que cette difficulté peut être contournée dans des conditions exceptionnelles. Mais il nous semble en attendant qu’on doive l’assumer avec réalisme. Nous l’avons dit dès le début : nous devons inventer et expérimenter des forme de lutte et de mobilisation adpatées au moment que nous sommes en train de vivre. Il faut redécouvrir le goût de la provocation créative, remettre à l’ordre du jour l’action directe et la désobéissance en les ancrant au sein des nouvelles conditions de vie et d’exploitation. Les flashmob de Non Una di Meno, qui chantaient Un violador en tu camino, nous offrent l’exemple de la manière de s’approprier l’espace public et de le transformer en scène “théâtrale” d’une représentation politiquement puissante et efficace. Plus généralement, des actions créatives et ciblées peuvent aujourd’hui produire une multiplicité de résonances et déclencher des processus plus vastes de mobilisation quand elles ne sont pas simplement l’expression de notre activisme mais incluent dès le début le protagonisme des sujets sociaux touchés par la crise. Construire des minorités actives capables de mettre en place des actions de ce genre nous semble une tâche fondamentale dans cette phase.
Traduction par Vanessa de Pizzol pour Tlaxcala
Testo in italiano