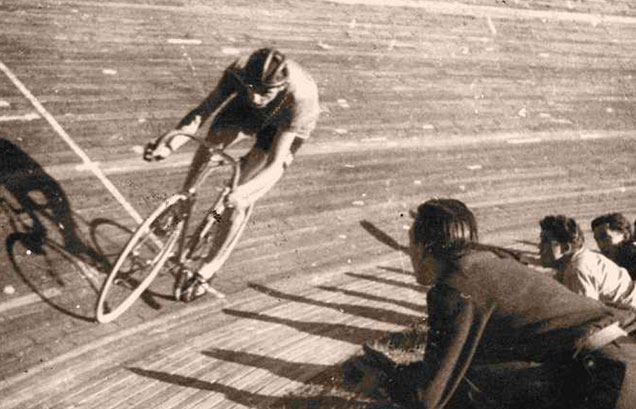Intervention au séminaire autour de Mario Tronti. Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 5 avril 2019.
Par TONI NEGRI.
Je dois avouer que je suis un peu embarrassé à l’idée de discuter de ce volume d’écrits de Mario Tronti, qui rend compte de la totalité de sa vie de chercheur et de militant. Quand j’étais jeune – pas si jeune que ça : un peu avant la trentaine -, Mario m’a appris à lire Marx. Ce n’était pas une petite responsabilité : je lui en suis, encore aujourd’hui, infiniment reconnaissant. C’est à partir de cette lecture que ma propre vie militante a pu prendre forme et exister. Mais six ou sept ans après cet incipit, précisément l’année où Mario nous offrait ce texte si formidable qu’est Ouvriers et capital, Mario a décidé de nous quitter – j’allais dire : a décidé de nous abandonner. Je ne dis pas qu’il m’a quitté, je dis qu’il nous a quittés, parce qu’entre-temps, les opéraistes que nous étions devenus, s’étaient faits nombreux, pas seulement dans les universités mais dans toutes les grandes usines du Nord de l’Italie.
Nous étions en 1966 : Mario nous dit alors que la décennie des années 1960 était en train de finir avant son terme, et avec cette décennie raccourcie l’époque de l’autonomie ouvrière ; il nous expliqua qu’il fallait trouver un niveau plus haut pour les luttes que nous avions menées et que nous continuions à mener, qu’il fallait amener la lutte dans le Parti communiste italien lui-même. Nous lui avons répondu : mais n’est-ce pas déjà ce que nous faisons ? Nous n’avons jamais été – ni à l’époque, ni plus tard – insensibles au problème du développement politique des luttes ouvrières, et à la tâche que cela impliquait. Le fait est que le Parti n’appréciait pas vraiment ce que nous faisions – si on me pardonne cet euphémisme.
Dans le crescendo des luttes ouvrières qui nous nous conduirait bientôt à ces deux années fondamentales que seront pour l’Italie, 1968 et 1969, nous ne comprenions pas pourquoi il s’agissait d’abandonner l’autonomie ouvrière à elle-même.
Une fois 1968 passé, Mario nous a expliqué que les événements nous avaient définitivement plongés dans la confusion. Selon lui, nous avions pris pour une aube ce qui n’était en réalité qu’un crépuscule. Mais quel crépuscule ? Bien sûr, la fin de l’hégémonie de l’ouvrier-masse commençait à se profiler, mais fallait-il pour autant la confondre avec avec la fin de la lutte de classe ? Pendant toutes les années 1970, ces années qui ont constitué le long prolongement de 1968 en Italie, cette conversion qui avait été celle de Mario n’a jamais réussi à nous convaincre davantage. Nous ne comprenions pas, nous avons continué à ne pas comprendre Quand le volume dont nous discutons aujourd’hui m’est parvenu, il y a peu, je me suis aperçu que je ne connaissais qu’un tiers des textes qui le composent. Les deux autres tiers m’étaient étrangers, ils restaient à lire. Cela dit, à sa manière, la profondeur d’une scission.
Si je dis que j’ai, à un certain moment, cessé de lire ses textes, cela ne signifie bien entendu pas que Mario était devenu totalement absent de mon horizon quotidien. Je me souviens avoir lu avec une certaine mauvaise humeur un essai d’histoire de la pensée politique moderne que Mario avait écrit et que j’avais trouvé partial – j’étais alors en train de devenir spinoziste, je n’avais pas vraiment apprécié l’exaltation sans réserve qui y était faite de la théorie hobbesienne du pouvoir. Comme si l’histoire de la pensée politique moderne pouvait ne pas être traversée, toujours aussi, par la pensée et l’histoire des vaincus, par la ligne de la révolte, par le rêve communiste, jusqu’à s’incarner avec Marx sous la forme d’une critique de l’économie politique et d’une intuition de la puissance de subjectivation de la classe.
C’est à cette figure-là de l’histoire moderne, bien différente de la sienne, que j’étais, moi, profondément lié ; et je l’avais précisément appris d’Ouvriers et capital : il fallait suivre « l’histoire interne de la classe ouvrière », c’est-à-dire l’histoire de sa subjectivation progressive. Ce que je tentais de mettre en pratique, c’était le développement de l’intuition trontienne qui insistait sur la nécessité d’évaluer le degré de maturité auquel était arrivée la subjectivation de la force de travail, au point de – je cite Ouvriers et capital – « compter vraiment deux fois dans le système de capital : une fois comme force qui produit le capital, et une autre fois comme force qui refuse de le produire ; une fois dans le capital, une fois contre le capital ».
Mais alors, pourquoi donc Mario oubliait-t-il d’un coup, dans le travail historique, la lutte contre le capital et la manière puissante dont le prolétariat se subjectivise ?
Toujours dans ces mêmes années, je crois m’être beaucoup fâché quand Massimo Cacciari et Alberto Asor Rosa, dans le sillage des analyses de Mario, ont attaqué Foucault – parce que, disaient-ils, Foucault dissolvait l’État, qui représentait à la fois l’objet et le sujet exclusifs de leur conception du politique. Il n’y avait plus d’ambiguïté possible. C’est à l’époque que j’ai finalement compris que le terrain politique que mes vieux camarades avaient choisi était représenté exclusivement par l’appareil de l’État, et qu’il était radicalement détaché du niveau de la lutte de classe. Quelle incroyable limitation par rapport au point de vue que nous offrait par exemple Foucault – Foucault, dont le concept de pouvoir était pour moi bien au contraire l’écho du dualisme du concept marxien de capital, en qui je reconnaissais « mon » propre Marx ?
Plus récemment, je me suis demandé avec une certaine perplexité ce que pouvait bien vouloir encore dire opéraisme, aujourd’hui, et quelle conception des jeunes chercheurs ou des étudiants peuvent en avoir – puisqu’on m’appelle, moi, post-opéraiste, alors même que je n’ai jamais cessé de reconnaître la nécessité de développer les intuitions politiques et les dispositifs de méthode du premier opéraisme, de l’opéraisme « pur jus », si vous voulez, celui des années 1960. J’ai essayé de le faire toujours, et j’ai continué dans l’analyse de la transformation de la composition de la classe et de la lutte de classe à un niveau international. Je tiens beaucoup à être reconnu comme opéraiste dans le débat philosophique et politique aujourd’hui : c’est une chose que j’admets sans fausse pudeur, parce que c’est mon histoire – et puis j’ai payé assez cher cette fidélité-là. Alors je laisse bien volontiers ce post- à qui a, au contraire, choisi de quitter l’opéraisme et de partir ailleurs il y a de cela bien longtemps. Au moment de la scission, qui fut un arrachement, j’étais à l’époque minoritaire ; mais comme souvent cela arrive avec les minorités, je sentais déjà à l’époque que le choix du Parti et de l’État, ce choix que faisaient ou allaient faire ceux qui avaient été opéraistes et ne voulaient plus l’être, ceux qu’aujourd’hui on continue à appeler opéraistes alors qu’ils ne le sont plus depuis cinquante ans – je sentais, donc, moi que l’on considère aujourd’hui comme un post-opéraiste, que ce choix finirait par se fracasser dès qu’on assisterait à la renaissance de la lutte de classe.
Pour éviter de me fâcher plus souvent, j’ai fini par me dire : il faudrait quand même que j’aille écouter plus souvent Mario, juste pour comprendre. J’étais rentré volontairement en Italie en 1997, après quatorze ans d’exil ; j’étais en prison, et Mario tenait la grande leçon qui devait mettre un terme à sa carrière universitaire, à Sienne, en 2001. J’ai donc demandé une permission de sortie spéciale, et à ma grande surprise, elle m’a été accordée. Je revoyais finalement Sienne après des années et des années (ce plaisir- là n’était pas totalement indifférent non plus). Cette lectio de Mario était intitulée « Politica e destino » – « Politique et destin ».
Je le dis avec l’affection de toujours – et je voudrais que ce soit clair : cette affection ne s’est jamais démentie, ni en 1966, dans les années 1970, ni en 2001, ni aujourd’hui – : j’ai compris à quel point nous étions devenus, Mario et moi étrangers l’un à l’autre.
Je connaissais bien Freiheit und Schicksal (« Liberté et destin »), le texte du jeune Hegel, qui avait été traduit et commenté en Italie par Luporini, et que Mario prenait comme point de départ pour son propre propos ce jour-là. J’avais moi-même travaillé longuement le texte pour mon habilitation. Et donc : qu’arrivait-il à ce texte fortement républicain du jeune Hegel dans la lecture qu’en donnait Mario ? En réalité Mario effectuait une sorte de glissement de la Bestimmung hégélienne au Geschick heideggérien, de la détermination éthico-politique de Hegel et de sa projection révolutionnaire sur la Begeisterung populaire – de cela, donc, à la décision heideggérienne de « l’abandon (de l’étant) dans l’être ». Mais pourquoi ce glissement ? Comment pouvait-on passer de l’enthousiasme hégélien à la mortifère réflexion heideggérienne ? La réponse était en réalité fortement métaphorique. Il s’agissait, pour lui, de la prise de conscience définitive de la crise d’un destin politique entièrement joué sur l’appartenance au Parti. Parce qu’il fallait bien s’y résoudre : en 2001, le Parti n’existait plus. Pourquoi ? Mario répondait alors de manière métaphorique : « Parce qu’il n’y a plus de peuple ! » (Il demone della politica, p. 577). Et donc : la « vocation », ou bien -je cite Mario – « la tâche qui nous revenait de nous organiser comme classe dirigeante, hégémoniquement dominante » n’existait plus.
Je me suis alors demandé : mais quelle est cette mythologie hégémonique qui fait réagir Mario d’une manière si dramatique – et à mon avis si désastreuse – face au présent de la lutte de classe ? Voilà ce en quoi consiste, pour moi, « l’énigme Tronti » – une énigme qui ne me semble pas impossible à résoudre : c’est un déplacement du point de vue, de celui qui consistait à être simultanément dans et contre le capital, à celui qui consistait à être dans le Parti – avec la proposition d’en imposer l’hégémonie sur le développement capitaliste. L’énigme, c’est la discontinuité profonde entre le Tronti d’Ouvriers et capital, d’une part, et le Tronti de « l’autonomie du politique ». Pour le dire autrement et de manière plus schématique encore, un déplacement de la source du pouvoir et de l’initiative de la lutte de classe – du bas vers le haut.
En 1972, le concept d’« autonomie du politique » avait émergé avec une grande clarté dans un texte dont le titre était précisément précisément celui-là – « L’autonomie du politique ». Il ne s’agissait plus du tout du résidu d’une tradition historique, ou de la mémoire de Hobbes. Le concept émergeait plutôt à partir de l’idée qu’il fallait en finir avec le « monothéisme » marxien, c’est-à-dire avec la prétention que la critique de l’économie politique et la critique de la politique puissent avoir la même source. Selon Mario, c’étaient au contraire deux pratiques critiques différentes. Politiquement, ce dédoublement était justifié, de manière pas totalement illégitime, par l’idée que, dans les années 1970, le capitalisme avait montré qu’il était insuffisant à soutenir l’État moderne, ou plus exactement insuffisant à soutenir le développement capitaliste sous la forme de l’État moderne. Mais si le capitalisme était en retard, raisonnait Mario, c’était alors à la politique que revenait la tâche de le secouer. Il fallait demander au politique de moderniser l’État. Et par « politique », on ne pouvait comprendre que la force de la classe organisée dans le Parti. A qui revient donc de moderniser l’État ? Je le cite : à « la classe ouvrière (qui) apparaît de ce point de vue comme la seule véritable rationalité de l’État moderne » (DdP, p. 297).
C’est ici qu’émerge ce qui est pour moi le paradoxe total. « Classe ouvrière comme rationalité de l’État moderne » : l’affirmation est rude à justifier, aussi bien par rapport à l’opéraisme « pur jus » – l’opéraisme du début des années 1960 -, que par rapport aux destins qui seront effectivement celui de la classe et celui de l’État moderne.
Dans le premier cas, la rationalité opéraiste avait représenté exactement l’opposé d’une fonction progressive du développement capitaliste ; parce que si elle en était la cause, c’était de manière antagoniste – mais en aucun cas comme une sorte d’agent instrumental, et encore moins comme une fonction rationnelle. Dans le second cas, si on avance dans le temps et qu’on suit le développement du rapport entre lutte de classe et État, il faut bien reconnaître que, dans les décennies qui ont suivi, ce rapport a fini par s’épuiser, en tout cas dans la forme métaphorisée que nous présentait Mario : la classe, quand elle agit en tant que force antagoniste et en même temps motrice du capital, ne sera désormais plus – plus jamais – représentée par le Parti.
Revenons donc à 1972.
Tronti reconnaît que l’autonomie du politique peut devenir un projet politique directement capitaliste. Dans ce cas, reconnaît-il avec honnêteté, cette autonomie di politique deviendrait simplement la dernière des idéologies bourgeoises. Mais aujourd’hui (aujourd’hui : on est dans les années 1970), elle peut aussi, dit-il, être réalisable en tant que revendication ouvrière. Je le cite : « L’État moderne apparaît alors comme rien de moins que la forme moderne d’organisation autonome de la classe ouvrière » (p. 298).
Ce rapport est perfectionné, une dizaine d’années plus tard, à l’époque de Berlinguer, quand on commence à parler de « compromis historique ». Je dis perfectionné, parce qu’il est accompagné d’une nouvelle sous-évaluation du rôle révolutionnaire de la classe ouvrière. Dit de manière théorique par Mario, cela donne – je cite – : « La classe ouvrière, sur la base de la lutte dans les rapports de production, ne peut gagner que de manière occasionnelle ; stratégiquement, elle ne gagne pas, stratégiquement elle est classe, dans tous les cas dominée ; mais si elle ne joue pas simplement sur le terrain de la classe, si elle coupe les cartes pour les redistribuer, et qu’elle investit le terrain politique, alors, apparaissent des moments dans lesquels le processus de la domination capitaliste peut être renversé ».
Voilà, très radicalement, me semble-t-il, toute l’évidence de la rupture de Mario avec l’opéraisme des années 1960.
Dans la discussion – puisque le texte sur l’autonomie du politique est le produit d’une discussion -, cette thèse est atténuée. Parfois, on assiste à la réintroduction du rapport duel de capital théorisé dans Ouvriers et capital – je cite : « A l’intérieur de la société capitaliste, il n’y a jamais une domination de classe univoque » (p. 305). Par ailleurs, j’imagine qu’en 1972, les participants à la discussion rappelaient à Mario l’intensité des luttes qui étaient en train de se dérouler. Et voilà comment Mario réagit, je le cite encore : « Un développement capitaliste de ce type ne peut fonctionner s’il n’élimine pas, en face de lui, cet appareil d’État qui ne correspond plus au niveau actuel du développement capitaliste. Voilà la prévision que nous faisons » (p. 307). Sur ce point, Mario avait sans aucun doute raison : c’est précisément le moment où le capital s’ouvre à la réorganisation globale de la souveraineté. Mais cette fois, la « grande politique » lui échappe. De manière assez ingénue, il pense en effet encore qu’il s’agit d’opérations qui sont internes à la trame de l’État-nation – et c’est donc ingénument qu’il ajoute, je cite : « Quand le capital décide de déplacer son action sur ce terrain – Tronti sous-entend encore une fois ici, à l’évidence, le thème de la réforme de l’État – la totalité du jeu de la lutte de classe se déplace à son tour, nécessairement, sur ce terrain, et affronte le problème de l’étouffement politique, et donc de la réforme de l’équilibre étatique avant même que le capital en ait pris conscience e puisse élaborer un projet de réalisation concrète et effective de cette réforme. Ainsi, le processus – je ne dirais pas de réforme mais de révolution politique de l’État capitaliste en tant que tel – est un projet que la classe ouvrière doit anticiper » (p. 307).
Et voilà alors la revendication de l’instrument que représente l’autonomie du politique – je cite : « Nous trouvons un niveau du mouvement ouvrier disponible pour une action de ce type » (p. 309). Et encore : « Pour un projet de ce genre, nous nous trouvons face à des instruments d’organisation qui, à cause d’une politique passée, à cause de leur structure interne, sont disponibles pour une action de ce type. C’est une situation historique paradoxale, mais c’est un paradoxe à utiliser » (p. 309).
On pourrait se moquer de ce « réalisme politique », mais à quoi cela servirait-t-il ? Il suffit simplement de mesurer, comme il est aujourd’hui possible de le faire, à quel point l’idéalisme en représentait le vrai fondement.
La classe doit se faire État : voilà donc en quoi consiste l’autonomie du politique – et c’est encore ainsi que cette autonomie apparaît dans Il tempo della politica, en 1980.
Le texte est très intéressant. D’un côté, on y trouve une certaine autocritique à propos de la condamnation de 1968 qui avait été celle de Mario à l’époque. Il y revendique par exemple la matrice ouvrière de 1968, et affirme même que, bien avant 1968, tout un cycle de luttes ouvrières victorieuses, au niveau européen comme au niveau mondial, y avait préparé.
Tronti donne des exemples à partir du « cas italien », à partir des processus qui ont amené les ouvriers en lutte à sortir des usines. Il ouvre même son analyse à une première définition du « social » comme nouveau terrain de la lutte de classe. Et il fulmine contre l’incapacité du Parti à absorber et/ou à entrer en relation avec les nouveaux mouvements – je cite : « lenteur des réflexes, peur de la nouveauté, instinct d’autodéfense » (p. 382-390).
Mais par la suite, comme si de rien n’était, on voit à nouveau revenir l’insistance sur le Parti comme clé de tous les processus. Ce qui est littéralement insupportable, c’est que tout ce discours se donne désormais à partir de l’effacement de toute approche critique de l’économie politique, et qu’il soit au contraire soutenu par un volontarisme vraiment bizarre. Je cite : « Rosenzweig indiquait une perspective de lecture de la politique moderne, von Hegel zu Bismarck. Est-il possible de prolonger cette ligne et de poursuivre le discours en rebattant les cartes – von Bismarck zu Lenin ? Seuls ceux qui n’ont aucun esprit de recherche, ceux qui ont peur de salir leurs idées en plongeant leurs mains dans les pratiques de l’ennemi, ceux qui pensent en petit, sur la base d’une cohérence idéologique et non pas à partir de la productivité politique d’un choix théorique, se scandaliseront de cela » (p. 408). D’accord. Mais alors il faut aussi rappeler qu’après avoir gouté ce passage à travers Bismarck, Rosenzweig a conclu à la mystique Stern der Erlösung (L’Etoile de la rédemption). Je ne pense pas que Tronti s’en offense – parce que c’est, me semble-t-il, le même parcours s’apprête lui aussi à faire. Je vais revenir sur ce point.
Mais je voudrais revenir au thème de l’autonomie du politique et continuer à en suivre le parcours. Nous sommes en 1998, et c’est un autre texte important – Politica Storia Novecento – Politique Histoire XXème siècle. Je le cite : « La phase de l’autonomie du politique se referme » (p. 524). Pourquoi l’autonomie du politique est-elle conclue ? Parce que, dit-il, « la défaite du mouvement ouvrier – nous sommes en 1998 – apparaît sans possibilité de rescousse d’aucun genre » (p. 325). Et voilà alors la séquence qui nous est proposée en guise de fuite – je cite : « La classe ouvrière n’est pas morte (…) mais le mouvement ouvrier est mort. Et il n’y avait pas de lutte de classe parce qu’il y avait la classe ouvrière, il y avait la lutte de classe parce qu’il y avait le mouvement ouvrier » (p. 528).
Bref : après la subordination de la lutte de classe à l’autonomie du politique, la lutte de classe finit à son tour avec la fin du PCI. On pourrait ajouter : CQFD mon général. Et suggérer ici une autre lecture de la question sur la fin de l’autonomie du politique : parce que la ligne de la pensée de Tronti va, à chaque fois, d’une erreur politique à la transfiguration transcendantale de cette dernière – et donc : de l’échec du « Parti en usine » à l’idée de l’autonomie du politique, de la crise de 1968 à l’affirmation de la classe comme État, de l’échec du compromis historique à la théologie politique, dans une fuite en avant absolument sans fin.
Tronti nous accorde quand même qu’il nous reste la révoltes des classes subalternes – je cite… « dans leur cours éternel » (p. 529). Le discours atteint donc l’éternel – de la même manière, aux p. 530-534 – je cite : « Le Dieu qui se fait homme et l’homme qui se fait Dieu ne se sont finalement pas rencontrés… et la onzième thèse de Marx sur Feuerbach (« Les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe c’est de le transformer ») doit être profondément mise en doute…. Le dogme de la praxis disparaît ». En somme : le PCI est fini, toute politique révolutionnaire est donc finie. Mais la même chose vaudrait pour toute politique progressiste ou révolutionnaire. Si elle n’était pas si fortement assenée, cette conviction pourrait presque émerger dans une lumière crépusculaire et entremêler la nostalgie du « peuple communiste » (une nostalgie qui nous est proposée à maintes reprises) et le sens de l’incompréhensibilité des temps nouveaux. Une sorte d’aura pasolinienne de Mario, en somme.
Dans le texte « Karl und Carl » (p. 549-560), le discours sur l’autonomie du politique, que l’on croyait fini, revient, mais dans une version sublimée. Tronti le présente comme « la dernière chose qui reste ». L’autonomie du politique n’est désormais plus liée à l’histoire du mouvement ouvrier ou à sa politique, mais bien plutôt proposée ici comme un fait ontologique, comme une nécessité de la pensée, de la vie et de la cohabitation humaine. Ce n’est plus un mode mais un attribut de l’être, pourrait-on dire ironiquement. Tronti reconnaît qu’au début, « l’occasion ingénue de la rencontre » avec Schmitt a été fournie, pour les opéraistes qui entraient au PCI en 1970, par une certaine – je cite – « ambition pratique d’arracher à Schmitt le secret de l’autonomie du politique afin de le remettre, en tant qu’arme offensive, au parti de la classe ouvrière » (p. 566). Cela confirme l’hypothèse donc que j’ai déjà faite. Mais il fallait aussi, ajoute Tronti, aller au-delà de la contingence. Il fallait reconnaître un tournant stratégique, et emprunter à Schmitt la pensée « du caractère originaire du politique, de la politique comme puissance originaire » (ce sont là les mots de Schmitt). La logique ne pouvait plus être conséquentielle. On avait de fait construit un nouveau monothéisme, opposé à celui que Marx avait dénoncé.
Que dire du reste de ce livre ?
Que, souvent, le jugement politique sur la réalité présente y est égaré par des résonnances spirituelles, théologiques et transcendantales. Le pouvoir y est définitivement deshistoricisé. A sa place, désormais, il y a le théologico-politique. Le sens du religieux imprègne le nihilisme qui à son tour découle de la déclaration de la fin du langage politique moderne et de son monde – une fin qui est contemporaine de l’épuisement du XXe siècle. Nous nous trouvons devant une sorte de précipitation catastrophique – comme on dit qu’on précipite dans un gouffre ; une chute inarrêtable. A présent tout est égal, tout se vaut, et la seule fonction de la pensée politique qui demeure ne peut être que celle du katechon. Il s’agit simplement d’essayer de bloquer, d’arrêter, de dés-accélérer cette chute dans laquelle nous nous trouvons entraînés.
Je suis un peu désolé que la tentative que représentait à l’origine Ouvriers et capital – une tentative pour reconquérir le politique à travers la subjectivation de l’acteur prolétaire dans la lutte de classe – finisse par une triste commisération de l’humaine virtù.
Cette virtù s’était nouée à la fortuna, et ainsi, dans le Parti, nous disait Mario, on pouvait non seulement se sauver de la ruine mais construire un monde nouveau. Mais une fois la fortuna évanouie, c’est la virtù qui doit disparaître à son tour. Il a bien peu de la pensée de Machiavel, ce destin. Dans les analyses de Machiavel, la « fortuna » qui disparaît est dans tous les cas, et toujours, porteuse d’une nouvelle « virtù » latente. Voilà la situation qui est la nôtre aujourd’hui. Et une pensée génétiquement si robuste, comme était celle de Mario, une pensée dont l’ADN opéraiste était si fort, n’aurait jamais dû perdre la capacité de le percevoir : la fin du Parti marque, bien entendu, la fin d’une époque ; mais elle signale tout autant la naissance de nouvelles subjectivations.
Pleurer sur les défaites produit toujours une fuite métaphysique stérile. Ce qu’il faudrait au contraire – mais Mario est bien loin de l’envisager -, c’est un repli difficile mais positif sur l’économie politique, une nouvelle interrogation sur la « composition » technique et politique de la classe des travailleurs qui, dans les contingences que nous affrontons, se constitue et s’offre sous de nouvelles figures. Comment la force de travail et le capital variable se sont-ils modifiés dans leur rapport au capital fixe, dans les transformations du mode de production capitaliste, et dans le passage de la phase industrielle à la phase post-industrielle ? Qu’est-ce que c’est que cette « intellectualité » qui constitue ou traverse la multitude des travailleurs, et quelles sont les formes de son être productif ? Et qu’en est-il de la nouvelle centralité de la coopération dans le travail, de l’augmentation de son intensité dans le travail immatériel, cognitif, en réseau, etc., de cette transversalité puissante ? Quelles sont les conséquences que tout cela détermine ? Si l’ouvrier social devient travailleur cognitif et greffe sur les qualités qui était les siennes (la mobilité et la flexibilité) la coopération linguistique et technologique, de quelle manière peuvent être redéfinis le rapport – et le saut – entre la composition technique et la composition politique du nouveau prolétariat ? S’il est vrai qu’à l’intérieur de ce tumulte de transformations, la seule chose qui ne change pas, c’est que le capital vit de surtravail et reconfigure, réarticule continuellement la survaleur et le profit, alors, ce rapport entre la composition technique et la composition politique est possible : c’est un dispositif latent à développer, et une tache politique à reconnaître.
Bien sûr, l’opéraisme doit être mis à jour. Il peut l’être : la socialisation de la production et le travail cognitif traversent désormais l’accumulation et la vie tout entière. Ce n’est pas un hasard si, dans la reproduction sociale, au cœur des existences, les mouvements féministes sont devenus centraux. Plus encore : le point de vue des « subalternes », quels qu’ils soient, montre sa totale syntonie, son lien, avec les mouvements de classe. Ne pouvait-on pas réactualiser à partir de ces nouvelles luttes et de ces sujets nouveaux, ce point de vue qui constitué l’opéraisme comme tel – cette manière de considérer tous les développements historiques de la lutte pour l’émancipation hors du travail « depuis le bas », depuis la lutte de classe des exploités ? Et donc : ne pouvait-on pas réactualiser aussi la capacité à donner à ce point de vue une intensité biopolitique et une extension universelle ? Bref : ne pouvait-on penser que, après la fin de la centralité de l’usine, la lutte de classe pouvait reconquérir ici, entièrement, sa virtualité révolutionnaire ?
J’arrête ici mes questions – on aura deviné les réponses que de mon côté, en tant qu’opéraiste, j’y apporte. Je voudrais simplement suggérer pour finir une idée de ce que l’on pourrait trouver, si seulement on relançait l’enquête sur la composition technique du prolétariat, et si on tentait d’en déduire des hypothèses sur une éventuelle nouvelle composition politique de celui-ci.
Cette composition politique ne peut se donner que quand la classe des travailleurs, une fois reconnue l’excédence productive du travail coopératif et/ou cognitif qui caractérise la nouvelle accumulation, se révolte ; et qu’elle se montre capable de tenir dans le temps la rupture du rapport de production, de construire du contre-pouvoir, et d’instituer en ce sens une légitimité constituante. Ici, le mot de politique est lié étroitement au verbe produire – non pas au sens où l’entendent les économistes, mais au sens de ce que luttes construisent : une libre capacité de produire et de commander sur la vie.
Je finis.
C’est, je crois, un dernier point qui est fortement polémique à l’égard de Mario. A la différence de ce qu’il soutient, à chaque fois qu’il veut articuler sa théorie du politique et/ou du pouvoir, Lénine n’a rien à faire avec l’autonomie du politique. Parce que Lénine a été, précisément, monothéiste – mais dans un sens opposé à celui de Schmitt : trouvant en Marx l’idée du politique qui, dans la matière, consistait essentiellement en la projection massifiée du travail vivant ; dans la forme, en une organisation de parti qui se calquait sur l’organisation de l’usine, sur la communauté productive ; dans le projet, en une entreprise révolutionnaire de construction du commun. Il n’y a pas moyen, chez Lénine, de détacher la matière de la forme. La référence qui est ici souvent faite à la NEP pour montrer le réalisme opportuniste de Lénine amène aux politiques staliniennes qui suivront plutôt qu’au modèle politique léniniste, dans lequel les thèmes de l’extinction de l’État, d’une transition comme phase de réappropriation et de transformation des pouvoirs de l’État par le prolétariat, et de la volonté de créer une société sans classes, sont au contraire évidents.
Il est bien vrai que, au fur et à mesure que Tronti avance dans son entreprise de destruction de la tradition communiste, il atténue cette manière de renvoyer Lénine à l’autonomie du politique. L’autocritique trontienne (mais je ne suis pas sûre que c’en soit une – puisqu’elle se présente toujours comme puissance de vérité supérieure) – l’autocritique, donc, semble changer de terrain. La mythologie après la théorie, l’ascèse après la mystique – je le cite : « Le marxisme du XXe siècle, dans la forme du léninisme, est très philosophie de la mythologie ». La modification est malgré tout appréciable. Il était extrêmement dangereux d’avancer sur la voie d’un Lénine entièrement acquis à l’autonomie du politique, parce que la chose portait en soi un fort accent de révisionnisme historique. Après Lénine égal à Bismarck, il y a Lénine égal à Hitler – idée au demeurant tout à fait acceptable pour Schmitt, -mais pour nous : jamais. Pour nous, cette équivalence n’est pas possible.
La référence au transcendantal politique, typique de la pathologie étatiste du XXe siècle – « détestable colère, qui aux Achéens valut des souffrances sans nombre », a par ailleurs fait son temps. Dans le monde globalisé, toute réminiscence étatique est destinée à se plier aux nécessités du souverainisme, de l’identitarisme, et alimente des dérives fascisantes, alors même que la figure de l’État pâlit toujours davantage dans le contexte de la mondialisation. L’État, bien loin de réapparaître comme un sujet autonome, a un rôle toujours plus subordonné dans le « jeu mondialisé des taux de profit ». Comme l’écrivaient tout récemment deux chercheurs et amis plus jeunes que nous, mais qui sont opéraistes comme nous l’étions il y a presque soixante ans – je cite : « On peut donc en conclure que l’État n’est pas aujourd’hui suffisamment puissant face au capitalisme contemporain. Pour rouvrir une perspective politique de transformation radicale, il est absolument nécessaire de trouver quelque chose d’autre, une source de pouvoir différente » (Sandro Mezzadra et Brett Neilson, The Politics of Operations).
Voilà donc là où la perspective opéraiste – celle que nous a offerte Mario il y a presque 53 ans mais qu’il refuse depuis presque aussi longtemps – peut nous aider. Si ma lecture du volume s’est arrêtée à son premier tiers, cela ne veut pas dire que, repartant de ce même premier tiers du volume, nous ne pouvons pas – aujourd’hui – redécouvrir à nouveaux frais le sens marxien du politique.